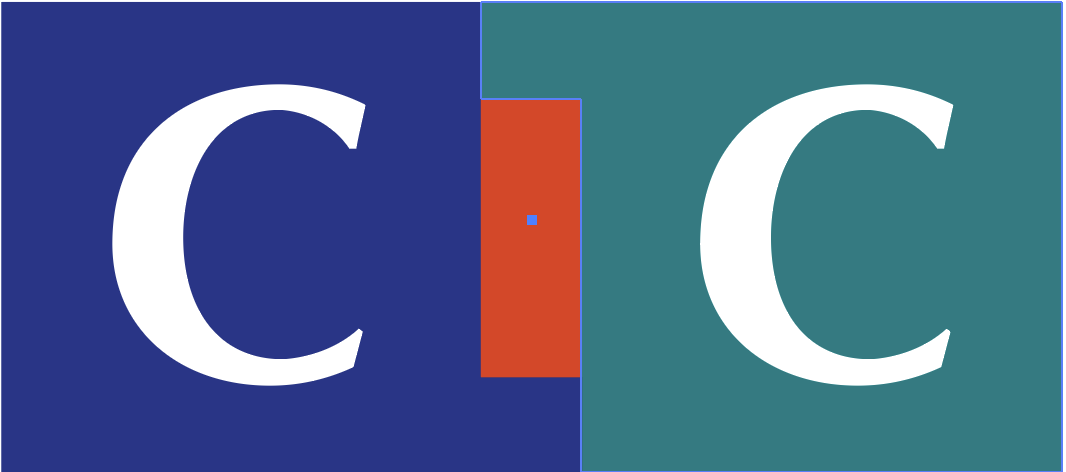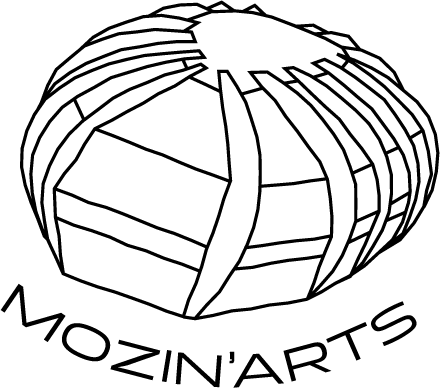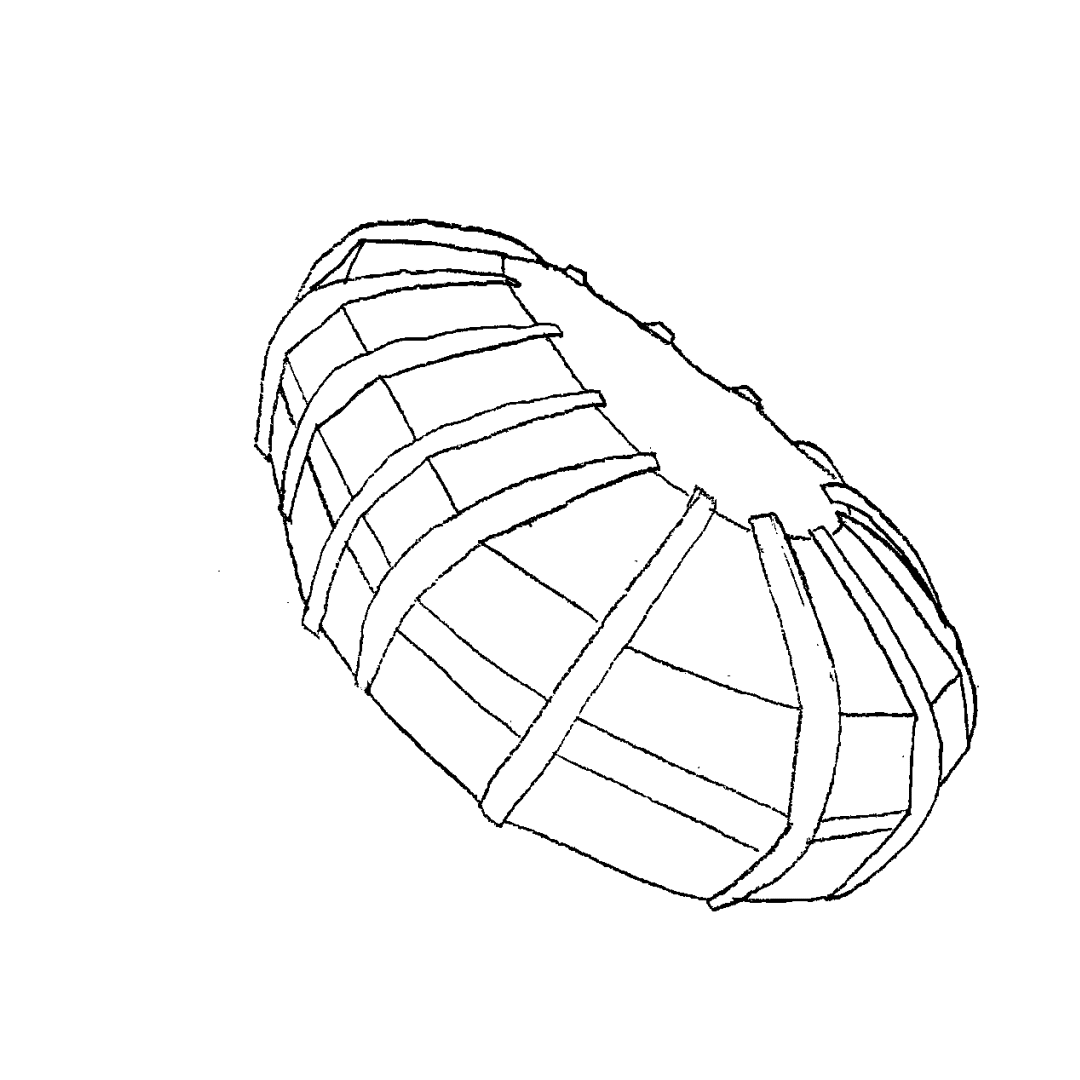Artistes 2025
.
Plus d’infos
Duo Louise Boghossian & Romain Vasset
Louise est une artistes multitask. Après 10 ans de danse, et de percussions au conservatoire elle entre à la Cambre en 2010 avec des installations sonores (section sculpture contemporaine). À Bruxelles, elle fait la rencontre du collectif Sin avec lequel elle fera ses premiers lives (noise, ambiant, expérimental…). Le collectif se fédère autour d’une pratique plastique liée aux dérivés sonores avec notamment la fabrication de leur propre sound system. Depuis 2017, Louise performe sous le nom de SPMDJ pour les dance floor discrets et inopinés des free, des squat, des grottes, ceux plus institutionnels de la Gaïté Lyrique et de la Philharmonie de Paris, et ceux plus univoques des clubs (La Machine, La Gravière, Zodiac…). Elle a aussi collaboré avec de nombreuses radios : Lyl Radio, Station Station, Kiosk, NTS, Netil, Rinse, entre autres.
Romain est multi-instrumentiste et compositeur. Après avoir fait ses gammes au Conservatoire de Clermont-Ferrand, il intègre la classe de composition électro-acoustique de Denis Dufour à Paris. Tout en étant actif dans la scène underground parisienne en programmant avec le collectif Pieg des concerts de musiques déviantes jusqu’en 2018, il a aussi collaboré avec de nombreux artistes de la scène pop qui lui a permis d’acquérir une expérience multiple de la scène avec ses différents instruments : basse, clarinette, claviers, machines. Il explore les croisements entre recherche sonore, improvisation et composition narrative avec un goût prononcé pour les interstices que lui permet son bagage polymorphe. Il est en ce moment actif avec son duo Belvoir (chanson expérimentale), son solo Quelque (clarinette et effets), et collabore avec Blumi (folk) à la basse, voix et clarinette. Par ailleurs, il a aussi réalisé la composition de musiques de films et de théâtre.
C’est par leur pratique commune de programmation de concerts et d’organisation d’événements DIY (DOC / Zorba / Café de Paris …) que Louise et Romain se croisent pour la première fois en 2019. À force d’échanges de ref et d’écoutes clairsemées, ils se retrouvent sur leur approche de la musique comme une matière sensible sculptée, qui part de l’intimité du geste plus que de l’exercice de style.
}Ï{ est né ainsi, d’une envie d’utiliser leurs enregistrements quotidiens respectifs de Dictaphones en les jouant comme des instruments pour finalement en créer des tableaux. Leur album « Phone’s Paintings » pourra donc s’écouter comme une œuvre musicale plastique qui navigue entre gestes électro acoustiques, abstractions poétiques, et improvisations.
Concert
}Ï{
•
Plus d’infos
Après 5 années d’études à l’école Boule de 1988 à 1993, Anjuna travaille pendant 7 ans dans différentes sociétés de bijoux fantaisie et haute-couture. Elle apprend alors les techniques de fabrication et se forge une maîtrise parfaite du métier.
Passionnée par l’univers du hip-hop émergeant en France, Anjuna se spécialise dans la réalisation de bijoux véhiculant les valeurs propre à ce milieu. Ce style est, à l’époque, encore méconnu en France et en Europe, mais déjà largement en vogue aux États-Unis. Anjuna développe alors son savoir faire unique et précurseur.
En 1996 elle dépose sa première collection de bijoux Hip Hop dans le magasin Ticaret, alors premier shop Hip Hop à Paris. Le succès est immédiat.
En janvier 1999, elle crée sa marque, Anjuna Bijoux, et en 2001, la boutique ouvre ses portes à Paris dans le 11ème arrondissement.
Aujourd’hui les influences d’Anjuna sont le hip-hop, l’Orient, l’Asie, l’architecture et la calligraphie…
Anjuna travaille désormais pour des particuliers, mais aussi pour de grandes marques ou des artistes renommés comme Lagerfeld, Adidas, MTV, Celio, Madonna, etc.
Anjuna est présentée dans le showroom de Erwan Boulloud
Bijoux hip-hop
Anjuna
•
Plus d’infos
Nothing rests; everything moves; everything vibrates
Eilert Asmervik est un artiste norvégien polyvalent qui se consacre principalement à la peinture et à la création sonore. Il a obtenu son diplôme de peinture à l’Akademie der Bildenden Künste Wien en 2024, en étudiant sous la direction de Daniel Richter, avec des échanges aux Beaux-Arts de Paris et à la Kunstakademie de Düsseldorf.
Asmervik vit et travaille de manière nomade, avec des bases à Paris, Graz (Autriche) et Lunigiana (Italie).
En tant que co-créateur du projet émancipateur InterStar Intl., il orchestre une activité rayonnante à travers un large spectre, plus récemment l’auto-édition multimédiale et la situation artistique Café Dasein (No Institute, Vienne, 2024). Depuis 2019, InterStar Verlag a publié des zines DIY et des publications à Oslo, Vienne, Amsterdam, New York et Paris. En tant que cofondateur de Cabanon Paris, il coorganise des expositions pop-up avec Anaïs Horn depuis 2023.
Ses œuvres ont été exposées à l’échelle internationale, notamment au Forum Stadtpark ; Graz ; Tutu Gallery ; NYC, b10b, Düsseldorf, Printed Matter, NYC, Sophie Tappeiner, Vienne, K.U.K, Trondheim.
Ras-Felios in Nicht-Licht-Aspekten von Sonnenschein oder auch die Zukunft
Eilert Asmervik
•
Plus d’infos
A Tower, a Flag
Sarah Bogner vit et travaille comme peintre, graveuse et éditrice à Vienne. Elle a étudié l’art à l’Académie des Beaux-Arts de Munich et la musique électroacoustique à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne. Elle a été membre de trois groupes : Hellfire, Apparat Hase et Steak. En tant que cofondatrice de Harpune Verlag, elle développe depuis 2011 le concept du livre d’artiste, en étroite collaboration avec des artistes internationaux. Le projet à long terme Moby Dick Filet y est également publié. Elle peint des chevaux roses et des natures mortes de fruits et de plantes, choisissant souvent des formats très grands pour occuper à la fois les espaces intérieurs et extérieurs, explorant ainsi la magie de la peinture. Les œuvres de Sarah Bogner ont été présentées dans de nombreuses expositions individuelles et collectives à l’échelle internationale, notamment à Zurich, Paris, New York, Munich, Heppenheim, Innsbruck et Vienne.
Der Turm
Sarah Bogner
•
Plus d’infos
À travers cette installation, Yse Bonachera cherche à poser un regard sur notre société « moderne » à travers ce qu’il est possible de retrouver quotidiennement dans nos écrans. Une invitation à s’asseoir et zapper pour contempler des images qui témoignent de l’absurdité de notre monde.
Yse Bonachera est née le 14 octobre 2002 à Arles. Travaillant initialement le textile, elle explore aujourd’hui une pluralité de médiums à travers lesquels elle traite de sujets écologiques, sociaux et politiques.
Dis stop
Yse Bonachera
•
Plus d’infos
Artiste, designer et artisan français, diplômé de l’école Boulle.
« Au-delà de sa réussite esthétique, une œuvre me paraît réussie dans sa capacité à générer de la descendance, pour moi, c’est le témoin de sa profondeur. »
Erwan Boulloud utilise une large palette de matériaux, exploitant le potentiel de chacun d’entre eux pour en faire ressortir une singularité. La matière est un terrain d’expérimentation pour l’artiste, qui n’hésite pas à brûler, polir, dénuder, décortiquer et reconstituer ses matériaux pour en dévoiler leurs multiples facettes et en révéler leur profondeur.
« Chaque pièce assemblée porte en elle une narration qui se déploie dans ses formes, ses matériaux et ses mouvements. »
Guidées par une logique darwinienne, ses créations naissent dans une effervescence perpétuelle, puis s’adaptent et évoluent pour former des lignées, des croisements ou des mutations avant de disparaître. Son travail, empreint de questionnements fondamentaux, prend racine dans un surprenant cheminement artistique et métaphysique.
« J’ai une passion pour tous les organismes et minéraux un peu mystérieux comme les pierres, les fossiles, les coraux, les météorites, les insectes… Tout ce qui invite à la réflexion, à la méditation, à la divagation. »
Ce goût pour ces éléments vivants et énigmatiques anime ses meubles sculpturaux, qui brouillent les frontières entre l’animé et l’inanimé. Avec poésie, Erwan Boulloud nous entraîne dans un univers où l’Histoire et le récit se croisent et s’entrelacent, effaçant volontairement la limite entre la réalité et le rêve.
Fasciné par les cycles de transformation, l’artiste tisse des liens entre mémoire, ésotérisme et science. Il fusionne les formes organiques aux matériaux précieux et références stylistiques pour illustrer des récits intimes et intemporels, dans lesquels l’art dialogue avec la science. Ses œuvres, véritables hymnes à la métamorphose, reflètent notre rapport au vivant, à la vie et ses créations, et aux frictions que celles-ci suscitent : elles nous offrent une méditation sur le mystère du monde qui nous entoure.
Les pièces de Erwan Boulloud sont présentées dans son nouveau showroom de Mozinor.
Mobilier de collection
Erwan Boulloud
•
Plus d’infos
Une installation de Véronique Bourgoin et une musique de Jeanne Susin
Avec une performance de François Lecoq et une collaboration avec Gilles Perez de la Vega
Dédale et Alchimistes est une installation à deux voix, entre la plasticienne Véronique Bourgoin et la compositrice Jeanne Susin. Conçue comme un opéra accidentel, le projet fait dialoguer deux univers artistiques distincts mais nourris d’un même ADN.
À travers le Tableau Périodique des Éléments Usuels, Véronique Bourgoin propose une critique visuelle et poétique des contaminations idéologiques et chimiques du quotidien, esquissant un « double sombre » du tableau de Mendeleïev. Scènes théâtrales, mannequins, objets hétéroclites « gelés », composent un paysage à la fois étrange et poétique.
En miroir, La Fileuse de Jeanne Susin incarne une figure d’alchimiste-guérisseuse. Elle manie des ondes grenues dans des artères de perle, ou fait couler des liquides aigus à travers les mailles de l’après-midi. On y saisit des sourires diaphanes, éclatés dans l’espace. Une apparition spectrale, formée de 0 et de 1, y fait circuler son énergie minimale : la machine nous aiguille. Nous suivons sa ligne tendue, guide de déblocage. Nous, comme des Icares-papillons aux ailes brisées, n’attendons qu’une goutte amoureuse. Elle est La Fileuse, mi-mythe, mi-archétype.
De la rencontre de ces deux œuvres naît une géométrie invisible : celle de l’organisation élémentaire de la matière, du politique et de l’émotion. Le spectateur est convié à s’égarer dans ce labyrinthe, entre science et mythe, toxicité et guérison, science et imaginaire.
Des mannequins ponctuent l’installation : figures muettes et spectrales, ils peuplent le « Tableau » de Bourgoin et scandent les scènes comme autant de répliques figées. Parmi les apparitions, deux mannequins jumelles sont assises dans une Mercedes couverte de poussière, écoutant en boucle une musique sur leur smartphone, bières et chips à portée de main. Un autre assis sur le grand plateau de béton, contemple les fragments du monde — le « Tableau » traversé par le public et animé par des présences fugaces qui troublent la déambulation : François Lecoq jouant une partie d’échecs avec des flacons dangereux face à un chien ; Dana et Stella tricotant le temps. La performance de François Lecoq, en dialogue avec la musique de Jeanne Susin, surgit comme un rêve dressé au cœur de l’installation, tableau vivant aux accents oniriques et inquiétants.
Enfin, Véronique Bourgoin investit l’œuvre de Gilles Perez de la Vega, The Wedding / Love Teardrops IV, garée sur le grand plateau de béton. Dans la remorque funéraire des années 1950 transformée en chambre nuptiale par Gilles Perez de la Vega, elle installe un couple médiatique — écho ironique au Tableau Périodique des Éléments Usuels — et signe une satire du mariage sur fond de géopolitique contemporaine. Dans le véhicule tracteur, une Fiat Belvedère Abarth Break, Gilles Perez de la Vega complète The Wedding / Love Teardrops IV par deux œuvres « attachées-case », qui agissent comme les traces d’une figure invisible et invitent le spectateur à prolonger la réflexion.
Véronique Bourgoin est une artiste plasticienne née à Marseille (France). Elle vit et travaille à Montreuil. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 1991, elle est nommée Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2023.
Sa pratique expérimentale, centrée sur la photographie, s’étend à la céramique, l’édition, le dessin, la peinture, la vidéo et l’installation. Elle explore les représentations du corps, de l’identité et du vivant dans des contextes mêlant imaginaire, simulacre et enjeux politiques contemporains.
Dès les années 1990, elle initie un réseau international de collaborations artistiques qui prennent forme au sein de la Fabrique des Illusions, association fondée en 1993 avec l’artiste Juli Susin, de l’Atelier Reflexe, école expérimentale de photographie (1995–2016), ainsi que dans le cadre de Royal Book Lodge, initiative née en 1989 avec Juli Susin autour de la création de livres d’artiste, qui a fait l’objet du livre « Royal Book Lodge » de l’historien John C. Welchman, publié aux éditions Hatje Cantz en 2023. En 2005, Véronique Bourgoin crée le groupe de performeuses The Hole Garden, une identité collective à l’origine d’actions performatives, de films et de séries photographiques. En 2024, elle initie, avec la musicienne et compositrice Jeanne Susin, la manifestation d’art contemporain Mozin’Arts, portée par la Fabrique des Illusions.
Véronique Bourgoin participe à de nombreuses expositions dans des institutions et festivals internationaux, parmi lesquels : Bibliothèque nationale de France (2023–24) ; Fotohof, Salzbourg (2000, 2004, 2007, 2015, 2021–22) ; Performa, New Museum, New York (2019) ; Photo Festival Landskrona, Suède (2013) ; Fotomuseum, Rotterdam (2013) ; Tütün Deposu Ek Bina, Istanbul (2011) ; Caochangdi Photospring Festival, Chine (2010) ; LA Art Center, Los Angeles (2009) ; Musée d’Art Moderne de São Paulo, Brésil (2009) ; Laboratorio Arte Alameda, Mexico (2005) ; Maison d’Art Bernard Anthonioz, Paris (2006–07) ; Biennale de la photographie de Thessalonique, Grèce (2010) ; Oscar Niemeyer Museum, Biennale de Curitiba, Brésil (2013).
Dédale et alchimistes
Véronique Bourgoin
•
Plus d’infos
Fondé en 2012 à Montreuil par Aniss Orblin, BoxCrew93 est né des premiers mouvements de breakdance, répétés au fond d’un garage de la ville. Ce collectif montreuillois s’est structuré en association en 2017 pour proposer des cours, des battles, des shows et des événements fédératifs partout en Île-de-France.
Leur progression fulgurante les a propulsés sur la scène internationale : en 2024, BoxCrew93 a participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sur une plateforme éphémère émergée sur la Seine, devant des centaines de millions de téléspectateur·rice·s.
Pluridisciplinaire et inclusif, le collectif est aujourd’hui composé d’une vingtaine de membres – danseur·euse·s, graphistes, vidéastes – construit sur la base de connexions artistiques et de partage de sensibilité. Forts de leur succès, iels se produisent également à l’international, comme à Los Angeles ou bien encore New-York. En parallèle, les membres animent des ateliers de breakdance destinés aux jeunes dès 7 ans, notamment au conservatoire de Montreuil, conservant leur ancrage géographique et social.
Box Crew est présenté en partenariat avec Est Ensemble.
Atelier hip-hop
Boxcrew
•
Plus d’infos
Cette installation propose une réflexion autour de la symbolique des portes, entendues comme seuils, filtres ou dispositifs de séparation. À travers la déclinaison d’objets du quotidien, l’artiste interroge leur charge symbolique souvent occultée : celle de la frontière, de la norme, de la régulation des corps et des regards. L’œuvre met ainsi en lumière la manière dont des éléments anodins, utilitaires ou familiers, participent à une logique plus vaste de codification sociale et culturelle, où l’ethnocentrisme s’infiltre dans l’usage même des formes.
À travers cette installation, l’artiste explore la multiplicité des significations associées aux portes, envisagées comme autant de seuils, de barrières ou de révélateurs. En détournant des objets du quotidien, Timon Bresson interroge les mécanismes de construction symbolique que l’humain projette sur son environnement, entre besoin de contrôle, obsession du territoire et formes d’absurdité codifiée. Les portes deviennent ici métaphores d’un monde anthropisé à l’extrême, régi par l’égoïsme humain, où se mêlent la volonté de se protéger, de se dissimuler ou de s’exposer.
Sans condamner l’objet en tant que tel, l’artiste propose une réflexion sur la charge sémiologique de l’objet et sur les résonances communes entre des éléments en apparence disparates, réunis par une même logique de séparation et d’ambivalence.
Timon Bresson fait partie de l’atelier Valérie Jouve
Les portes, les portes, les portes
Timon Bresson
•
Plus d’infos
Les thèmes écologiques et infrastructurels sont au cœur du travail de Céline Brunko (qui vit et travaille à Zurich et à Paris). Pour l’exposition, elle présente trois photographies exposées directement sur des plaques d’aluminium et une pièce sonore qui émerge à travers un tuyau de ventilation.
Les photographies montrent les interventions humaines dans le paysage depuis une vue aérienne extrême : carrières, usines industrielles et axes infrastructurels. Leur esthétique évoque des associations avec des images satellites ou des captures d’écran de Google Earth et soulève la question de savoir si ces sites pourraient être des installations secrètes. Le choix d’images en noir et blanc renforce l’effet de distance et d’abstraction. Il crée un sentiment d’aliénation entre l’extraction des ressources et leur utilisation quotidienne dans la construction et la technologie.
L’œuvre sonore Undermining (2017-2025) y introduit une dimension auditive. Entendues à travers un tuyau de ventilation, les enregistrements de gravières, d’usines et d’autres environnements industriels transforment un élément architectural de l’espace d’exposition en un corps résonnant.
Céline Brunko (1987) vit et travaille à Zurich. Elle a étudié la photographie à l’Université des arts de Zurich et les Beaux-Arts à l’Académie d’art et de design FHNW de Bâle. Ses œuvres vidéo, audio et basées sur des objets abordent principalement des thèmes tels que l’architecture, l’utilisation des sols, l’exploitation minière et la nouvelle matérialité. Dans sa pratique, elle utilise des récits spéculatifs comme méthode pour concevoir des scénarios futurs possibles.
Ses œuvres ont été présentées, entre autres, au MAK Center, Los Angeles, États-Unis ; à la Durden and Ray Gallery, États-Unis ; au Cabanon, Paris, France ; à la Haus Konstruktiv, Zurich, Suisse ; à la Kunsthalle Winterthur, Suisse ; au Helmhaus Zurich, Suisse ; au Photoforum PasquArt, Bienne, Suisse ; au Schaulager, Bâle, Suisse ; au Kunsthaus Baselland, Suisse ; Kunstraum Kreuzlingen, Suisse ; Heiligenkreuzerhof, Vienne, Autriche ; « re|vision » European Experimental Film Festival au MIT, Cambridge, Massachusetts, États-Unis ; Fondazione Fotografia Modena, Italie.
Parallèlement à ses activités d’exposition, elle participe depuis 2016 à un projet de recherche architecturale à Chisinau, en Moldavie, et a eu l’occasion de travailler sur un projet interdisciplinaire à l’université de Toronto.
A Silent Land IV-VI / Undermining
Céline Brunko
•
Plus d’infos
Ces sculptures performatives réinventent les possibilités du mouvement en engageant les corps dans une expérience immersive. Les performeur·euses traversent un boyau de huit mètres, où se déploie une chorégraphie de la désorientation, une dépense d’énergie brute proche de l’extrême. Pensées comme un sport fictif, ces formes invitent à projeter les corps hors de leur environnement d’origine, comme en apnée ou dans le vide, pour explorer de nouvelles façons d’être et d’habiter le monde.
Gustave Cagani est un artiste vivant et travaillant à Paris, diplômé d’un DSAA mode collection et accessoire à l’école Duperré, il poursuit ses études aux Beaux-arts de Paris.
De sa formation en mode, il garde une appétence pour le travail du textile et un intérêt particulier pour le patronage et les techniques de montage propre à la confection de vêtements.
Il mène à Paris une recherche sur l’artifice, costume, sculpture ? Au prisme du corps en mouvement. Dans son travail, le costume est un outil, un dispositif qui s’active dans la performance, ces mécanismes organisent et dirigent les rapports de ceux qui prennent part à l’expérience. En piratant l’interface qui fait le lien entre le corps et son environnement, il devient possible d’entrevoir des potentialités inédites, de nouvelles manières d’être eu mondé.
L’atelier de conception devient un laboratoire d’expérimentation multiple, un espace dynamique et évolutif, aux compositions imprévisibles et immédiates.
Les matériaux utilisés sont les réactifs d’une expérience risquée, une dispute qui s’engage entre le corps et l’artifice. Son dernier projet Choux-Choux est une installation performative hybride, sous la direction chorégraphique de Matisse Di Maggio, accompagnée par une composition sonore d’Elouann Durieu. L’ensemble est pensé comme un environnement immersif qui rejoue échelle un le récit d’une contamination microscopique.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
CHOUX-CHOUX
Gustave Cagani
•
Plus d’infos
Série de toiles fabriquées à partir de tissus provenant des proches de l’artiste. Suite à la fabrication d’une couette à but plutôt utilitaire, l’artiste a souhaité trouver une manière de reproduire les motifs colorés sous formes de tableaux abstraits, en reprenant les codes du cadre en bois et de la toile tendue. Certaines sont également tendues sur des planches de bois sculptées, permettant des jeux de formes riches en possibilités. Comme pour les tissus, les planches ont été récupérées et étaient destinées à l’oubli.
Une dizaine de toiles on été produite en 2025.
Max Carré est un artiste pluridisciplinaire né à Paris, qui a travaillé plus de sept ans à Montreuil. Après des études en mathématiques, il découvre la peinture abstraite et s’immerge dans l’huile sur toile, produisant entre 2017 et 2019 de nombreuses œuvres dans son atelier.
Attiré par l’univers du pain et de la pâtisserie, il ouvre ensuite Chapel, un laboratoire expérimental dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, où pendant trois ans il propose pains et gâteaux inédits dans un décor inspiré de ses créations graphiques.
Depuis, Max cherche de nouveaux styles d’expression visuelle et expérimente beaucoup avec le patchwork. Ce nouveau moyen de peindre, plus manuel, ouvre un champ des possibles. Il cherche, à l’avenir, à continuer à combiner peinture, illustration et gastronomie.
Peinture en patchwork
Max Carré
•
Plus d’infos
Doppelgänger, cabeças de ouro est une installation composée de cordes de jute, bambou, métal, film, épingles et pierres. Ce masque orné d’un œil de serpent, conçu lors de la première année de résidence de l’artiste à la Fabrique des Illusions, inaugure une série de huit masques réalisés entre 2023 et 2024. Les cordes semblent s’enrouler autour d’un coyote doré, laissant apparaître une seconde figure, informe et transpercée d’épingles : un animal impossible à identifier.
Puisant à la fois dans ses errances en forêt dans l’ouest de la France, son imaginaire de l’Amazonie urbaine nord-brésilienne et le paysage montreuillois (fresques de street art, hybridité industrielle et jardins suspendus de Mozinor), Alex crée une pièce totem qui détourne le mythe du double comme présage néfaste. Ici, le doppelgänger devient un révélateur de la fragmentation identitaire et du travail de l’inconscient.
Alex est un artiste visuel et intellectuel queer, travesti·e et non-binaire, originaire de l’Amazonie urbaine du nord du Brésil. Installé en France depuis 2016, iel développe une pratique qui puise à la fois dans ses déplacements, ses lectures et son ancrage identitaire.
Son travail interroge les représentations queer et non-humaines dans les espaces de l’art contemporain et du spectacle, en explorant les frontières entre culture et nature. À travers la réutilisation de matériaux organiques, inorganiques et synthétiques, iel se relie aux enjeux écologiques et façonne des sculptures en cordes qui convoquent l’animalité. Sa démarche déconstruit l’identité et met en scène une forme d’« apocalypse du genre », où le devenir animal et l’écossexualité ouvrent de nouvelles perspectives sensibles.
Ses masques, fruits d’une recherche sur les sens, le silence, le regard, l’érotisme et le geste, constituent des objets à la fois intimes et performatifs. Plasticien depuis deux ans, Alex crée aujourd’hui ses pièces à la Fabrique des Illusions à Montreuil.
Doppelgänger, cabeças de ouro
Alex Hel Chermont Brandão
•
Plus d’infos
Comment actualiser le mythe du fruit défendu ? Adam regardait-il d’abord la pomme ou le corps d’Ève ? En dignes descendantes de la première femme, les pin-up forment le cortège d’un menu varié qui colle à nos humeurs. Dès lors anatomie rime avec gastronomie. Sensuelle ou grave, mutine ou joviale, princesse ou amazone chaque pin-up revisite ses charmes en faisant un pied de nez au regard affamé des hommes.
Sous les ciseaux de Sidony Cloud, les calendriers sexy et les revues de charme croisent les livres de recettes et les magazines culinaires comme les deux grands genres qui assignent aux femmes une place bien déterminée. Mais ce mélange espiègle crée un court circuit inattendu : qui croyait manger risque d’être mangé. Attrapé sur le fil du désir, le regardeur hésite devant cette synthèse chimérique des instincts. L’analogie joyeuse du corps et des aliments forme un caprice auquel on se sait si l’on doit céder. Reine ou serveuse, impératrice ou cuisinière, c’est bien de bonne chair/chère dont il s’agit.
Comme un défilé de mode un jour de marché, la confusion des genres pique au vif notre culture qui associe trop vite séduction et consommation. Echappées du Jardin des Délices, les pin-up transformées en mythiques agapes ramènent la joie légère des parfums et des saveurs sur le terrain du regard et de l’inaccessible. En brouillant les codes de l’appétit, les pin-up font parfois grincer des dents mais il nous fait surtout rire de nous-mêmes par le raccourci opéré entre le rituel du dîner galant et le charme vintage de la bagatelle.
Sidony Cloud est engagée dans une pratique d’art singulier fondée sur le photo-collage. À partir de magazines, d’agendas mais aussi d’ouvrages d’histoire de l’art ou de la photographie qu’elle découpe, elle reconstruit des ensembles qui prennent le plus souvent la forme de livres d’artistes de petits formats. Son univers est aussi grinçant que joyeux et en tous les cas volontiers provocateur. Son iconographie se plaît à déjouer les conventions et les convenances, ses travaux ont la force des tracts et la douceur du journal intime. En libérant une énergie libidinale de haute intensité, son œuvre forme une ode à la psyché féminine.
Pin Up food
Sidony Cloud
•
Plus d’infos
Ce volume associe un ballon de baudruche et un masque. Renvoyant à l’univers des célébrations, du carnaval et de l’enfance, ces deux objets évoquent principalement la légèreté de l’amusement. Mais ici, la mise en forme sculpturale en détourne le sens. Suspendue à l’envers et pourvu d’un aspect minéral, presque pierreux, l’impression de lourdeur court-circuite la fête annoncée. L’insouciance festive bascule alors vers une chute.
Née en 2000 à Rosny-sous-Bois, Flora Coupin est une artiste plasticienne qui travaille à Paris. Scolarisée aux Beaux-Arts de Paris depuis 2020, elle y développe une pratique de la peinture, de l’installation et de l’écriture. Sa production s’articule autour de questions liées à l’intime, alternant entre les notions de care et d’hostilité. En piochant dans une pluralité d’esthétiques, elle assume des dynamiques de contradictions et d’oppositions. Elle reçoit les enseignements de Pascale Marthine Tayou, puis de Michel Blazy. En 2023, elle est diplômée de la filière Fresque et Art In Situ et en 2024, elle reçoit le diplôme de premier cycle. En 2025, dans le cadre d’un Erasmus, elle intègre l’Universität der Künste à Berlin et étudie dans l’atelier de Christine Streuli.
Flora Coupin a participé à quelques expositions collectives comme Unes à la Hune, regards (sur les) féminins, Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois en mars 2022 ; Au(x) Pluriel(s), à la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois en mars 2023 ; Inconscience à la Galerie Amarrage en janvier 2025 ; Presque 11000 jours à la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois en mars 2025.
Depuis 2020, Flora Coupin est la chargée de production plastique de l’artiste Ndayé Kouagou, représenté par Nir Altman à Munich et Gathering à Londres. Elle a notamment participé à la production des expositions pour la Fondation Louis Vuitton The guru en 2023 ou le Frac Ile de France A Change of Perspective en 2023-2024. Elle a également travaillé pour le festival Perform de Sarah Trouche durant les étés 2022 et 2023.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Helium Accident
Flora Coupin
•
Plus d’infos
Pour Mozin’Arts 2025, le bateau Bibliothèque de matali crasset accueille la BK Mobile pour une navigation-exploration à travers les collections d’archives et de livres d’artistes de la Bibliothèque Kandinsky, centre de recherche et de ressources du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, autour du graphisme militant, des dérives post-situationnistes de l’urbanisme unitaire, par un nécessaire flash-back 1967 du temps où Maïakovski était exposé à Montreuil, et pour rappeler que l’art est toujours le meilleur moyen de résistance. En présence de Thomas Bertail, Mica Gherghescu, Victor Guégan et Nicolas Liucci-Goutnikov.
“Lorsque Juli Susin demanda en 2010, à matali crasset de concevoir une bibliothèque pour rassembler les édition Royal Book Lodge (Silverbridge), elle eut l’idée d’un ‘bateau’ constructiviste, qui devint un hybride combinant la forme d’un porte-conteneurs que Susin avait vu naviguer sur le fleuve Paraná, entre Buenos Aires et Asunción, et d’un meuble en acajou acheté par ses parents lorsqu’ils ont émigré de Moscou à Berlin, qui symbolisait l’idée typiquement soviétique ‘d’ appartement de luxe’. Cet objet domestique occupait une place importante dans les souvenirs de Susin de sa nouvelle maison occidentale ; occupant tout un coin du salon de ses parents, il était doté de nombreux espaces modulables, vitrines et tiroirs, et devint un lieu de stockage pour la famille, puis une sorte d’archive contenant des livres, des services de table, des vêtements : un labyrinthe où l’on trouvait absolument tout”. (Extrait du texte John C. Welchman, “Royal Book Lodge”, édition Hatje Cantz, 2023).
“A la question ‘Pourquoi désignez-vous’ matali répondait : ‘j’entrevois de plus en plus ce métier, à travers les projets que je mène, comme celui d’un accoucheur, d’un maïeuticien. Il s’agit de moins en moins de mettre en forme de la matière – de l’esthétique – mais plutôt de faire émerger, de fédérer, d’organiser, autour d’intentions et des valeurs communes, des liens et des réseaux de compétences, de connivence, de socialité.’ Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’esprit de matali et sa manière d’envisager le design.
On pourrait s’étonner que l’univers baroque de Royal Book Lodge (Silverbridge) rencontre les lignes de l’univers plus strict et rigoureux de matali crasset, mais ils se connaissent depuis plus de vingt ans ; matali a suivi l’évolution du projet silvebridge et elle se reconnaît dans ce désir de collaboration, de curiosité et d’ouverture loin des dogmes et en dehors de rapport au style.
matali crasset a souhaité poser la collection des éditions Royal Book Lodge (Silverbridge), cette boite de Pandore, dans un bateau: un objet qui porte et transporte nos corps et nos utopies.
Un bateau porteur des rêves et des rencontres de Royal Book Lodge (Silverbridge), mais aussi un objet matrice qui sera à nouveau un support de rencontre et création.”
(Extrait Communiqué de presse, exposition Mysterious Cruise, 2010, Galerie Sophie Scheidecker)
Bibliothèque-Bateau BK Mobile
matali crasset
•
Plus d’infos
Au centre de l’installation se trouve un lit une place (90×200 cm), recouvert de draps bleu ciel. Un corps en ouatine, à l’allure de nuage, y est recroquevillé. À ses côtés, une lampe de chevet diffusant une lumière chaude et un téléphone portable connecté à une multiprise. Sur l’écran défilent des paysages forestiers aux teintes de métal rouillé, accompagnés de sons hybrides, nature altérée, résonances bétonnées, et d’une fine mélodie au piano.
Autour du lit s’élèvent puis s’effondrent des bâtiments de tailles variables (de 20×20×20 cm à 170×40×40 cm), construits à partir de déchets électroniques patinés. Ces masses métalliques sombres et rouillées encerclent peu à peu le lit, menaçant de l’envahir. L’agencement et le nombre de ces structures évoluent selon l’espace d’accueil, conférant à l’installation un caractère mouvant et adaptatif.
Gaïa est une artiste constructrice nomade né et ayant vécu dans les banlieues est de Paris. Elle est diplômée de ENSAV la Cambre à Bruxelles en scénographie. De la construction d’une école aux décors de cinéma, elle travaille autour de l’espace et la réinvention de celui-ci. Au cours de ses différents projets, elle transforme et invente des univers.
Des univers où résident questionnements politiques et philosophiques.
Des espaces qui poussent à nous interroger et désirer la réinvention de notre environnement.
Oscar Dahyot est un videaste, photographe et plasticien. Il est né à Paris, a vécu dans le Vexin et dans les banlieues Est de Paris. Il vit actuellement à Bruxelles, où il y développe ses projets, explorant le sommeil, la disparition et l’apparition.
Les villes ne mangent pas de nuages
Oscar Dahyot & Gaïa Adri
•
Plus d’infos
Cette installation naît d’une récolte d’objets, d’écrits et d’images effectuée dans l’appartement des grands-parents de Mona Daimallah à Alger, juste avant sa vente. Au centre de ce travail : les boîtes aux lettres du bâtiment, à la fois seuils et réceptacles d’intimités, chargées de gestes répétés, de mots et d’affects. Leur remplacement imminent a déclenché une démarche de sauvegarde, non pas pour les restaurer, mais pour en préserver la mémoire.
À partir d’une photographie unique, l’artiste façonne des répliques en céramique : lourdes, fragiles, privées de noms et de destinataires, elles incarnent un espace fantôme et matérialisent l’absence. En contrepoint, une boîte en bois abrite une projection vidéo — un geste familier et répétitif de son grand-père — comme un fragment d’intime mis en boîte. L’objet posé dessus, reproduction d’une de ses “fabrications”, évoque un lien suspendu entre les mains et la chose fabriquée.
Dispersées dans les interstices de Mozinor, les archives et fragments collectés deviennent des chutes orphelines, déplacées de leur contexte initial. Entre séparation et rapprochement, disparition et survivance, l’œuvre interroge ce qui subsiste d’un chez-soi lorsqu’il n’existe plus, et comment ses traces peuvent s’ancrer dans un espace nouveau.
Mona Daimallah est née en 2000 à Alger. Après l’obtention de son Bac, elle commence ses études en art contemporain à Paris, d’abord à la Sorbonne puis à Paris 8. Son dernier sujet de mémoire de master portait sur la notion de coupure, avec pour sujet : comment saisir le lien à travers la coupure ? En 2023, elle est lauréate du prix Michel Journiac et rejoint les Beaux-Arts de Paris un an plus tard, intégrant les ateliers de Valérie Jouve, Angélica Mesiti et Marion Naccache.
Sa pratique plastique personnelle se caractérise par un travail à partir d’enregistrements filmiques et sonores récoltés à Alger. L’élaboration de ses réalisations vidéographiques se fait en cycle sur deux temps, deux lieux, deux saisons.
En été, elle met en place un processus de collecte d’images et de sons. Elle capture ce qui est présent dans son environnement, des paysages, des visages, des textures, des discussions à travers des gestes simples : observer, filmer, archiver.
En hiver, de retour à Paris, elle emporte ces témoignages, provisions et morceaux du quotidien d’Alger. Ils constituent une banque d’images, de sons et d’objets qui forment la matière première de ses expérimentations plastiques. La phase de montage, assemblage et agencement débute à travers la recherche d’un tissage entre les différents fragments déplacés.
Par ailleurs, elle pense ses installations comme un prolongement de ses vidéos, marquant les continuités, les ruptures, et permettant de matérialiser cette relation à la coupure au croisement du documentaire et de l’expérimental.
À frontière du chez-soi
Mona Daimallah
•
Plus d’infos
Composée de sculptures et de vidéos, la pratique de Raphaël Delannoy aborde des univers flous où les symboles (personnages, lieux) issus des récits mythologiques sont détournées, cherchant ainsi leurs connotations contemporaines. Au travers de différentes
figures tirées du folklore, de la mythologie ou des jeux vidéos, sa pratique propose des mises en scènes où différents personnages se melent pour former de nouveaux récits, à mi chemin entre la satire et le cadavre exquis.
Son travail a été présenté à The Koppel Projet à Londres, à Ygrec à Aubervilliers, à l’espace Topic à Genève, à la Central Saint Martin à Londres, ou encore à Points communs à Cergy. Raphaël Delannoy vit et travaille à Paris, il a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux arts de Lyon ainsi qu’à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Haleine
Raphaël Delannoy
•
Plus d’infos
Né dans le nord de l’Argentine et installé à Paris depuis 2018, Pablo Delgado est comédien (qui danse et qui chante), pédagogue de théâtre et professeur de yoga.
Formé à l’université en théâtre dans un cursus mêlant théorie et pratique avec une forte empreinte corporelle, il a enrichi son parcours par des spécialisations dans le travail vocal et le mouvement, dans une approche holistique qui relie corps, voix, souffle, énergie et émotions. Ancien gymnaste, il cherche aujourd’hui une pratique scénique qui unit jeu, danse et voix, à travers des compositions visuelles habitées de sens et de présence.
En parallèle à sa création artistique en tant qu’interprète, il anime de nombreux ateliers où se croisent théâtre, expression corporelle et vocale. Enseignant au Cours Florent, au Conservatoire de Bagnolet et dans différents centres sociaux, il inscrit sa démarche dans une recherche de communauté et de réciprocité : aller vers l’autre, construire ensemble, donner, recevoir, nourrir et se laisser transformer.
Expérience performative
Pablo Delgado
•
Plus d’infos
Collaboration Apolline Destom ; Dahlia Koum Sam
Les installations & sculptures hybrides d’Apolline et Dahlia se chevauchent et se rencontrent dans les Jardins Mozinor : des paniers trouées sont cachés par ci par là : dans l’arbre ou sous la terre, c’est l’Easter Egg / la Chasse aux Oeufs.
Ils nous guident vers une plus grande installation, celle d’un sanctuaire textile, d’une chapelle accueillant une performance processionnelle et progressive – un rituel du toucher et du soin.
L’espace devient un refuge sensible, un lieu d’assemblage, de mémoire et de lutte.
L’œuvre s’active à travers une performance-lecture sonore, une Perf Pommade, qui propose un rituel de soin partagé : raconter pour apaiser, étaler un baume, une boue pour ce qui brûle en nous. Entre mythe et manifeste, cette œuvre explore notre politique de la sensibilité, la puissance d’agir des objets, la mémoire des corps, et l’importance de faire circuler nos émotions. C’est une tentative de traverser les temps, les ruines : du fossile à la fiction actuelle, pour faire advenir de nouveaux récits.
Deux corps plongent dans une fontaine d’argile vivante, recouverts de matière aqueuse, archaïque, leurs gestes lents, immobiles, laissent apparaître sous la terre des traces, des racines, constellations, circuits : la peau devient une carte vivante.
Cette installation-performance est un rite de dévoilement. Elle s’ouvre sur un bain de boue, se poursuit par une lente traversée proscessionnelle jusqu’à un sanctuaire textile, et culmine avec l’apparition de drapeaux monumentaux ; les banderoles sensibles, slogans flottants, peaux étendues au vent. Les peaux craquelées rencontrent les cabanes tordues, dans un axe entre temps géologique incertain et futur spéculatif.
L’installation tisse un espace de soin, de lutte et de mémoire collective. Une liturgie mutante où l’argile, les mots, les perles, les tissus et les corps redessinent les contours de la Map, entre invocation poétique et manifeste incarné.
Apolline Destom est une artiste plasticienne vivant entre Strasbourg et Paris.
Conçus comme des portails, des seuils vers des mondes humides et oniriques, les oeuvres d’Apolline cherchent à tisser des liens avec ce qui nous échappe. Laisser l’intuition guider la main, suivre les chemins qui se dessinent, prêter attention aux signes d’un monde qui grouille d’invitations discrètes.
Dans une tentative d’habiter l’entre-deux, elle explore la vulnérabilité des environnements comme des corps, les relations entre ce qui résiste et ce qui se défait. Dans ses installations, se rencontrent plusieurs savoirs-faire, fragments glanés ici et là, comme une revendication d’émancipation et d’autonomie de confection. Dans ces formes, elle exprime ses ruines, celles d’un bégaiement générationnel, mais aussi l’urgence, la nécessité de prendre soin de nos mondes réels et imaginaires.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Sans titre
Apolline Destom
•
Plus d’infos
Installation sonore
Elouann Durieu est un auteur et compositeur sonore. Après un cursus audiovisuel où il apprend les métiers du son, il se lance dans l’installation sonore pendant son passage à l’erg. Après 2 années dans cette école et voulant en savoir d’avantage sur le langage et la composition du son, il s’inscrit en composition acousmatique au Conservatoire royale de Mons. Il réalise des bandes sonores électroacoustique pour des films, documentaires sonores et sort son premier projet musical en duo courant Octobre. Dans ses compostions, on retrouve de nombreuses matières sonores difficiles à classifier. Ses sons proviennent très souvent du vivant, captés à l’aide d’enregistreurs. Il les retravaille par la suite pour leur donner une nouvelle entité, mais tout en gardant leur vie intrinsèque.
Fil à plomb est une installation sonore qui transpose la verticalité architecturale de Mozinor dans le champ du son. Inspiré par l’outil traditionnel composé d’un fil lesté, l’artiste conçoit un dispositif où les haut-parleurs (des exciteurs) font vibrer directement les supports sur lesquels ils reposent, transformant la matière en véritable système de diffusion.
La composition n’est pas pensée selon l’espace stéréophonique horizontal, mais dans une logique ascendante : le son circule de bas en haut, épousant la verticalité du lieu. Dans ce geste, les haut-parleurs deviennent métaphoriquement le fil à plomb, révélant une expérience d’écoute qui met en vibration l’espace autant que l’imaginaire.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Fil à plomb
Elouann Durieu
•
Plus d’infos
Créée dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette œuvre provient du projet La Ruée vers l’Or, fruit d’une collaboration entre ebb.global, Lafayette Anticipations, les Ateliers Médicis et 60 lycéen·nes de Clichy-sous-Bois. Imaginé comme un parc de loisirs fictif, immersif et interactif, ce projet donnait forme aux visions et préoccupations de la jeunesse, inventant de nouvelles pratiques sportives ou détournant les règles existantes. En s’appropriant les codes de l’industrie du divertissement, La Ruée vers l’Or interrogeait les valeurs et les mythes contemporains, tout en explorant des manières inédites de produire, jouer et penser collectivement.
Cette œuvre trouve une résonance profonde avec l’esprit de Mozin’Arts. Toutes deux partagent un même rapport à l’expérimentation collective, à l’ancrage local et à la remise en jeu des codes établis. Pensée comme un dispositif participatif où le public est invité à manipuler et s’approprier l’objet artistique, La Ruée vers l’Or rompt avec la distance imposée par l’espace muséal traditionnel, une ambition que Mozin’Arts porte également, en favorisant la proximité entre le public, les artistes et leurs œuvres. Par son implantation voisine de Mozinor et par le dialogue qu’elle ouvre avec l’utopie industrielle du lieu (machine à rêve capitaliste), l’installation de Neil Beloufa, comme un reflet du Zeitgeist actuel, s’inscrit dans un continuum où patrimoine culturel, création contemporaine et engagement citoyen se rencontrent. À l’instar des ateliers menés à Mozinor avec les jeunes du Centre Tignous, elle traduit la conviction que l’art peut être un espace de co-création, de pensée critique et d’imaginaire partagé.
Ebb.global est un studio qui allie technologie et créativité pour donner vie à des projets engageant les publics et intégrant des outils numériques dans le domaine culturel. Co-fondé par Neïl Beloufa et porté par une équipe composée d’artistes, de cinéastes, de commissaires d’exposition, de chercheurs et de développeurs, Ebb.global se consacre à la création d’expériences interactives, immersives et multimédias, tout en participant activement à l’élaboration de nouveaux modèles de diffusion, en phase avec les valeurs émergentes de notre société.
Parmi les projets récents d’Ebb.global figurent Pandemic Pandemonium à la Secession de Vienne (2022), Sahab Museum avec le Hawaf Collective au Palais de Tokyo, Paris (2024), La Ruée vers l’or avec Atelier Médicis à Lafayette Anticipations, Paris (2024), Humanities à la Kunsthalle de Bâle et à la Renaissance Society, Chicago (2024), Me Time à LUMA, Arles (2024–2025).
Ebb.global collabore avec des artistes et cinéastes tels qu’Alain Guiraudie, Jill Mulleady, Nicolas Sassoon ou Tony Oursler.
Ebb.global bénéficie du soutien de Europe Créative, du CNC et de la Caisse des Dépôts.
ebb.global
•
Plus d’infos
Elias Devoldere est l’un des batteurs les plus dynamiques de la scène belge. Ces dernières années, il s’est également révélé comme auteur-compositeur et chanteur. Avec la sortie de son premier album solo Bloomed > Exploded (2023), on peut désormais ajouter « producteur » à cette liste. Nous avons découvert Elias en tant que batteur avec Nordmann, Robbing Millions, Das Pop, Hypochristmutreefuzz, Suwi et Peenoise, parmi tant d’autres. Après un EP intitulé Kaiku (2021), Bloomed > Exploded est son premier album complet en tant qu’artiste solo. Cet album intimiste, qui évoque le passage à l’âge adulte, se caractérise par une atmosphère intangible, des mélodies cristallines et des rythmes discrets, et a reçu un accueil chaleureux de la presse belge. « Pur », c’est ainsi que Bruno Ellingham, l’ingénieur britannique qui a mixé l’album, l’a décrit, à la grande joie d’Elias, qui avait contacté Ellingham en raison de son travail précédent avec des groupes tels que Massive Attack et Portishead.
Concert
Elias
•
Plus d’infos
HØST d’Ari Erom capture l’essence de l’automne nordique dans une sculpture qui dialogue entre saisons et modernité. Cette œuvre transforme l’arbre traditionnel en constellation de cubes miroitants aux reflets cuivrés et dorés, évoquant les dernières feuilles qui s’accrochent aux branches avant l’hiver. Chaque cube reflète les nuances automnales – bronze, ambre et terre brûlée – créant une symphonie chromatique qui évoque la mélancolie douce des paysages scandinaves. Le tronc d’inox poli ancre cette vision dans une esthétique contemporaine, tel un pilier technologique couronné par cette explosion géométrique saisonnière. Les reflets changeants des surfaces polies créent un spectacle visuel qui évolue avec la lumière, transformant chaque moment d’observation en nouvelle découverte. Cette sculpture incarne le passage du temps et la beauté éphémère de l’automne nordique. Cette œuvre transforme l’espace en méditation sur le cycle des saisons, où chaque reflet raconte l’histoire de la transformation perpétuelle de la nature. Un manifeste sculptural qui célèbre la poésie de l’automne dans un langage artistique contemporain.
Ari Erom est présenté par Enzyme Design.
HØST
Ari Erom
•
Plus d’infos
La Nuée : installation monumentale en alliage de laiton
Série Méandres
Le Jeu : œuvre textile
Le Lien : œuvre photographique avec insert de laiton
Ces 3 oeuvres composent un triptyque évoquant les héritages, liens et transmissions. Elles interagissent ensemble à travers Mozinor comme les pièces d’un rébus ou d’un jeu de piste.
Non obscura est une quête universelle, la réconciliation avec le passé, la recherche du sens de sa propre vie.
La Nuée est l’œuvre matricielle, l’histoire d’un lien ineffable et indéfectible, une liaison profonde établie entre le ciel et la terre.
C’est une histoire d’amour et un trait d’union.
La série Méandres prend la maison comme fil conducteur, au milieu de lieux connus / inconnus, il s’agit de réécrire sa propre histoire.
C’est le temps remonté, là où il aura fallu chercher pour que surgisse la lumière de ce que l’on croyait être les ténèbres.
Mathilde Eudes vit et travaille à Montreuil, artiste plasticienne et architecte d’intérieur de formation, formée à l’Esag Paris, elle pratique la photographie, le dessin, le textile et l’écriture poétique.
La Nuée en extérieur et Méandres en intérieur dans la soucoupe composent l’acte 2 de sa série Non Obscura. L’acte 1 a été présenté aux 1ères Mozinarts l’année dernière.
En 2025 son travail a également été exposé à Paris la galerie la Moulinette et au salon unRepresented puis dans l’Orne au château de Maison-Maugis dans le cadre du parcours Art et Patrimoine en Perche N°6.
Non obscura
Mathilde Eudes
•
Plus d’infos
La dernière bouchée est une sculpture tridimensionnelle qui mêle l’imaginaire de la forêt, l’esthétique de la boucherie et les coutumes de la chasse. Son titre fait référence à la tradition de la brisée qui consiste à placer une branche d’essence noble dans la bouche des cervidés mâles tués, comme un dernier hommage. Autour du cerf, quatre jambes déstructurées pendent, leurs formes anthropomorphes évoquent l’univers de la marionnette, tandis que les objets qui les accompagnent renvoient aux carcasses.
L’œuvre oscille entre rituel ancien et scène contemporaine de boucherie. La structure s’élève afin de mieux comprendre la dualité complexe de notre rapport à l’animal : la possibilité de manger de la viande quotidiennement sans jamais voir de cadavres ni participer à leur mise à mort, tout en ressentant sensibilité et empathie envers d’autres espèces. Une entreprise possible grâce à la délégation de la violence.
Popline Fichot est artiste, sourceuse de récits, diplômée de l’École Duperré en 2023. Elle vit et travaille entre Paris et le Morvan.
Elle cherche à déployer un espace où l’invisible se révèle et où le tangible se réactive en mémoire vivante. Une invitation à prendre l’étrange dans notre écosystème.
Elle travaille à la construction d’entrelacs d’histoires parallèles, qui interrogent la vie des objets et notre lien aux mort·es.
Ses œuvres mêlent des matériaux organiques et instables à des structures métalliques existantes, dans une pratique hybride de moulage, assemblage et modelage qui provoque une ambiguïté délibérée.
Les rouages de ses sculptures s’inspirent du théâtre de marionnettes et du stop motion.
En 2021, elle crée sa première performance Descendantes des sorcières à la Ménagerie de Verre. En 2023, elle présente Les Fulgurées aux Abattoirs – Frac Occitanie Toulouse.
Elle expose Cabinet d’amulettes : Bones à Love&Collect (2022) et participe à Fine Dying (Institut suédois, 2023), Je est un autre (Galerie Sophie Scheidecker, 2024). En 2025, elle est lauréate de la Galerie du Crous de Paris.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
La gravitation des semences / La dernière bouchée
Popline Fichot
•
Plus d’infos
Pablo Feix
•
Plus d’infos
L’installation de Monica Fossati dialogue avec le projet présenté par la Ressourcerie du Cinéma.
OxyGen Limited imagine un futur archéologique où nos objets du quotidien, précieux, utiles ou banals, devenus le socle de notre mode de vie, sont exhibés en reliquaire d’un culte disparu.
Au sommet de cet autel, un jeune arbre se dresse, silencieux et fragile. Il n’est pas un symbole, il est vivant : ses feuilles filtrent l’air que nous respirons, ses racines tissent l’humus de notre nourriture.
Le public est invité à un rituel : offrir une goutte d’eau à la plante. Ce geste, à la fois dérisoire et vital, devient une prière silencieuse adressée à la Terre-Mère — ce dieu qui ne réclame rien, endure tout, et demeure pourtant le maître de notre survie.
Monica Fossati a eu une précédente carrière en tant qu’experte scientifique et communicante dans le développement durable. Ingénieure polytechnicienne (EPF), elle a consacré un quart de siècle à déployer une pédagogie active de la transition écologique : sensibiliser, traduire les enjeux en solutions, accompagner le changement. Ses collaborations vont des grandes institutions comme l’ONU Environnement et l’ADEME, aux entreprises de tous horizons. Elle est également à l’origine de guides professionnels, dont Ecoprod, référence de l’audiovisuel écoresponsable. Son geste fondateur avec Ekwo, premier magazine éco-citoyen grand public, a inscrit dans la sphère médiatique une communication responsable et visionnaire.
Dans le prolongement, Monica Fossati a développé des actions sur le terrain, en particulier dans sa ville, Montreuil, où elle est engagée aux côtés de communautés culturelles et écologistes tels les Murs à Pêches. Ici, elle conçoit un land art utile et intégré à la nature, où l’œuvre est pleinement présente : elle s’ancre dans l’écosystème et dialogue avec lui, agissant comme un vecteur esthétique et citoyen.
Aujourd’hui, l’art s’impose pour elle comme un langage à part entière – émotionnel, intuitif, engagé, universel.
Bientôt diplômée de l’École d’Art de Montreuil (2026), elle explore des formes d’art participatif, collaboratif et polysensoriel, où l’expérience ne se réduit pas à la contemplation mais devient immersion, partage et co-création. Ses œuvres se présentent comme des espaces de reliance et de transmission entre individus et environnement, mais aussi entre intériorité et monde collectif.
Son travail interroge le bien commun, la fragilité du vivant et du lien, et la capacité des gestes infimes à devenir des actes poétiques ou politiques. Chaque projet est conçu comme une expérimentation sensible, où la rencontre, le geste et l’échange se transforment en matière artistique. Ainsi se déploie une œuvre qui conjugue éco & égo, vision planétaire & vivre ensemble, force du partage & calme de la résilience. Un élan qui cherche, à travers le sensible, à relier et à transformer le monde.
Oxygen Limited
Monica Fossati
•
Plus d’infos
Cette installation associe tirages photographiques et sac de frappe, conférant à l’ensemble une dimension spectrale. Elle évoque une présence à la fois invisible et indéniable, perceptible par ses seules traces : impacts figés sur le sac, silhouette à demi effacée du boxeur en préparation, gestes suspendus comme dans un souvenir fuyant.
À travers ce dispositif, Achille explore l’instant présent dans toute son intensité, l’insaisissable euphorie du mouvement, son embrasement et sa disparition. L’œuvre capture l’effort physique dans ce qu’il a de plus éphémère, tel que l’éprouvent les boxeur·euses à l’entraînement ou en combat : une énergie fulgurante qui se consume aussitôt qu’elle se manifeste.
Sans titre
Achille Genet
•
Plus d’infos
Ici trois impressions A3 de mon chien Dimanche sont collées à un banc de jardin, puis vernis. Ce banc, que je connais bien, devient la raison de l’image. Ce geste percutant condense une partie de ma démarche : travailler avec ce qui est à portée de main pour transformer telle ou telle chose en une continuité. Les propositions ne cherchent pas l’éclat mais davantage une « position » propre. Elles trouvent leur force dans le rapprochement, spontané, de deux réalités. — Josquin Gouilly-Frossard
Josquin Gouilly Frossard est né en 1980 à Paris ; il vit et travaille depuis quatre ans en milieu rural, tout d’abord en Belgique et maintenant dans la Vienne (86).
Son œuvre se construit lors d’expositions et utilise la photographie, le livre d’artiste, la sculpture et l’installation. Ses projets sont individuels ou collaboratifs. L’instantanéité́ et la mise en scène se chevauchent et s’indifférencient dans sa pratique.
Expositions personnelles récentes à Liège en Belgique 2023, Au Café des Glaces à Tonnerre en Bourgogne, France 2022, au DOC à Paris en 2020.
Sans-titre 2025
Josquin Gouilly-Frossard
•
Plus d’infos
Ce film dépeint une figurine qui s’est entourée de représentations d’eau gothique et qui tente, à travers des mouvements de danse simples et lents, de décrire la dérive sans trace d’un être indéfinissable à travers un terrain cristallin qui semble s’étendre inexorablement vers sa propre dissolution.
Guðný Guðmundsdóttir est née en 1970 à Reykjavik, Islande.
Diplômée de la Hochschule für bildende Künste de Hambourg en 2001, elle vit et travaille à Berlin.
The Flooded Paths of the Tragediennes
Guðný Guðmundsdóttir
•
Plus d’infos
L’installation d’Anaïs Horn, I Hear You in the Mirror, I See You in the Wind, tisse miroirs, cloches et chaînes de bijoux dans un arbre vivant. Développée pour la première fois dans le cadre de son exposition Talk to Me au Fotohof Salzburg en 2025, où elle occupait le plafond de l’espace d’exposition, l’œuvre s’inspire des recherches de Horn sur les symboles apotropaïques, les amulettes et le mauvais œil. Suspendus aux branches, les éléments réagissent au vent et à la lumière du soleil, générant des reflets, des mouvements et des sons subtils, oscillant entre ornement et organisme talismanique.
La pratique pluridisciplinaire d’Anaïs Horn se déplace avec fluidité à travers les médias, créant des environnements intimes, souvent spécifiques à un site. Son travail retrace la tension entre la présence et l’absence, où les récits personnels — fragments autobiographiques, rites de passage ou biographies de figures (féminines) historiques —évoluent vers des réflexions plus larges sur l’existence contemporaine et sur la manière dont les souvenirs et les récits résonnent à travers la présence spectrale d’objets et d’espaces. Elle introduit fréquemment des éléments d’illusion et de mystère, situant son travail dans un espace intermédiaire.
Née à Graz (Autriche), Horn est basée à Paris et en Lunigiana (Italie). Avec une formation en design et en littérature, elle est diplômée de l’école Friedl Kubelka, à Vienne, en 2015. En 2023, elle a cofondé Cabanon, un espace d’exposition pop-up parisien, avec Eilert Asmervik. En 2022, elle cofonde Drama Books, une maison d’édition indépendante, avec Boah Kim.
Des monographies de son travail ont été publiées par DCV, Berlin ; Meta/Books, Amsterdam ; Edition Camera Austria, Graz ; Edition Fotohof, Salzburg, et Drama Books, Paris.
Parmi les expositions individuelles ou en duo, citons Camera Austria, Graz ; Galeria RGR, Mexico ; Sophie Tappeiner, Vienne ; Fotohof, Salzbourg ; MLZ Art Dep, Trieste ; Easter, Collesino (IT) ; kunstGarten, Graz ; NADA New York ; MiARt, Milan ; Curiosa, Paris Photo, Paris.
Parmi les présentations de groupe sélectionnées, citons le Lentos Museum, Linz ; le MAK Museum of Applied Arts, Vienne ; Les Rencontres d’Arles, ISCP, NYC ; P.A.D., NYC ; Tutu Gallery, NYC.
I Hear You in the Mirror, I See You in the Wind
Anaïs Horn
•
Plus d’infos
Yanis Houssen, originaire de Saint-Pierre (La Réunion), vit et travaille à Montreuil. Après une formation scientifique, il se tourne vers la photographie et intègre en 2002 l’Atelier Reflexe, école expérimentale fondée par Véronique Bourgoin et Juli Susin, où il collabore avec de nombreux artistes internationaux.
Ses premières séries (Surface, Between, Places) explorent la matérialité et la temporalité de l’image et sont exposées dans divers festivals et institutions en Europe et à New York. Entre 2008 et 2012, ses voyages en Asie mêlant retraites méditatives et prises de vue nourrissent sa recherche.
Depuis 2011, il développe la série Hippocampe, issue d’accidents techniques liés au procédé complexe du Transfert Carbone qu’il expérimente depuis plus de cinq ans. Ces images altérées révèlent la structure même de la photographie, entre précision numérique et rendu analogique, et questionnent la matérialité, la vulnérabilité humaine et la résilience.
Yanis Houssen
•
Plus d’infos
« Un flot d’émotions s’écoule sans fin.
Je l’accueille, et dans le souffle suivant, je le transforme en photographie.
Pour moi, la photographie n’est pas tant une réponse claire qu’une trace des courants intérieurs que je ne peux contenir.
Ces œuvres participent de ce processus, comme respirer l’inexplicable. » — Kotaro Iizuka
Ce travail cherche à donner corps aux émotions qui n’ont nulle part où aller.
À travers les mouvements d’un danseur, ces sentiments indicibles et instables trouvent une forme.
Kotaro Iizuka les saisit en images, non comme des réponses figées, mais comme des traductions fugitives de ce qui échappe aux mots.
Dans ce dialogue entre mouvement et immobilité, il espère que le spectateur pourra rencontrer ses propres émotions invisibles.
Crédits :
Danseur : Evgeny Ganeev / @evgeny_ganeev
Créatrices de vêtements :
– Lara Augstein / @laramz.studio
– Nadine Riemer / @na_gxnr
Photographe : Kotaro Iizuka / @kotaro_iizuka_
Né en 1996 dans la région enneigée d’Akita, au nord du Japon, Kotaro s’est intéressé à la photographie dès son plus jeune âge. C’est une série d’expériences et de rencontres intenses et inspirantes lors de séjours en Australie et en Israël qui l’ont convaincu de se lancer dans une carrière de photographe. De retour au Japon, Kotaro a trouvé un emploi dans un studio à Shibuya, Tokyo, où il a passé deux ans à se perfectionner sur le plan technique et professionnel. Cette période a vu s’épanouir le portfolio personnel de Kotaro, à mesure que son style, ses compétences techniques et ses relations dans le secteur se développaient. Kotaro s’est installé à Paris à l’automne 2023, où il travaille désormais comme photographe spécialisé dans la mode et le portrait.
Wandering through an emotional wasteland
Kotaro Iizuka
•
Plus d’infos
Ce projet crée un pont entre social et plastique à l’aspect clinique. Il vise à convertir des voix, organiques et chaudes, en dessins informatiques via un programme codé hébergé sur un site internet. C’est un recueil de témoignages sur la mémoire et les souvenirs en ricochets. Ce recueil devient implicite et abstrait grâce à sa conversion numérique.
Jano est né·e à Paris en 2001. En s’engageant dans un cursus à La Cambre en dessin, elle a pu développer de nombreux axes. Artiste pluridisciplinaire, elle s’investit autant en composition musicale qu’en arts visuels.
Elle s’est également spécialisé·e dans la pratique du tatouage. Elle perçoit la relation et la transmission entre plusieurs personnes comme centrale et essentielle à son travail.
Suite à son master, elle se dirige vers la recherche entre médecine et art. Elle a consacré son mémoire de fin d’étude à la récolte de témoignages sur les souvenirs ricochets. Comment vivre une histoire qui n’est pas la sienne ?
Maintenant, elle compte poursuivre ses recherches entre neurologie et art, expérimenter de nouveaux protocoles en repoussant les limites du tatouage et de la modification corporelle.
Cartographie de la mémoire
Jano
•
Plus d’infos
Vincent Jehanno compose, joue et improvise des musiques à partir d’enregistrements microphoniques et de transformations en temps réel à la bande magnétique. Il s’’intéresse au son en tant qu’objet-trace et objet de réminiscence qui peut prendre la forme d’instantanés acoustiques originellement très hétérogènes : collectages de terrain, archives sonores récupérées ou personnelles, espaces en résonance, musique en décomposition, sons dégradés et résiduels de bande magnétique. Il joue en concert sur un dispositif électro-acoustique se composant essentiellement d’un magnétophone à bande, un Revox B77, d’une platine, de différents micros et de transducteurs.
Vincent Jehanno
•
Plus d’infos
Les fleurs, les territoires, les humains s’immiscent dans la rigidité du fer, des lignes droites, des calculs, des mesures de la machine, un besoin d’afficher la différence d’être.
La terre renaît, la bascule de la planète se construit maintenant, sans connaitre son issu, nous, peuple, choisissons notre place.
Un certain monde a réussi à construire une machine sociale monstrueuse mais le peuple arrive avec son corps, son environnement, sa puissance.
Valérie Jouve est née en 1964 à Saint-Étienne. Elle vit et travaille à Paris.
Photographe et cinéaste, Valérie Jouve parcourt sans relâche la ville à la recherche de ses habitants. Observatrice du paysage urbain, elle capture un espace singulier à un moment précis, remettant en question notre façon de voir et de percevoir les choses.
Le travail photographique de Valérie Jouve a développé deux entités : les humains et les paysages, et plus généralement la ville et ses périphéries. Chaque image est construite autour de la notion de rencontre entre les corps, qu’il s’agisse d’individus, d’architectures ou d’éléments du paysage. C’est un espace mouvant, fluctuant et partagé que l’artiste met en évidence dans ses photographies. Cadres serrés, corps suspendus. Les personnages ne sont ni caricaturaux ni anecdotiques. Lorsque Valérie Jouve photographie des personnes, si l’image est le prétexte de la rencontre, c’est finalement la rencontre qui devient le prétexte de l’image.
Valérie Jouve aborde le médium photographique non pas comme un moyen de montrer, mais plutôt comme un moyen de ressentir et de stimuler le rapport intuitif du spectateur. Si chaque œuvre conserve son autonomie, l’ensemble se déploie dans l’espace. À l’instar d’une composition musicale, Valérie Jouve considère l’accrochage des œuvres comme un moyen de produire un mouvement qui naît de la coexistence entre les images.
Elle a présenté d’importantes expositions individuelles au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole et au Petit Palais à Paris (2018), au Jeu de Paume (2015), au MAC/VAL (2014), au FRAC Basse-Normandie (2011), au Centre Pompidou (2010), au Sprengel Museum de Hanovre (2005), à l’IAC de Villeurbanne (2003) et au Musée de Winterthur en Suisse (2002). Son premier film, Grand Littoral, réalisé en 2003, a été présenté dans de nombreux festivals, ainsi qu’au MOMA de New York en 2004.
En 2024, le CPIF (Centre Photographique d’Île-de-France) lui consacre une exposition personnelle intitulée « Le monde est un refuge », à partir du 11 février. Son travail est également présenté dans l’exposition collective « Corps à corps » au Centre Pompidou, visible jusqu’au 25 mars 2024.
Collections publiques (sélection) : Musée Albertina, Vienne, Autriche ; Centre Pompidou, Paris ; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ; Bibliothèque nationale, Paris ; Stedeljikmuseum, Amsterdam ; Walker Art Center, Minneapolis, États-Unis ; Musée Folkwang, Essen, Allemagne ; Musée de l’Elysée, Lausanne, Suisse.
Série Immiscions
Valérie Jouve
•
Plus d’infos
Artiste plasticienne, Maya Kafian réalise des installations vidéo figuratives et narratives qui sont activées lors de performances. Elle pense des environnements totaux, dispositifs immersifs pour des personnages qui sont autant burlesques que poétiques et dans des formats allant de la saynète à l’opéra-théâtre en plusieurs actes. Fonctionnant comme un espace ouvert, ses dispositifs scéniques mêlent le public aux performeurs·se·s.
Performance : Douves
Maya Kafian
•
Plus d’infos
Le quatuor Kaija, formé sous l’impulsion de Camille Garin, s’inscrit dans un mouvement d’ouverture, naviguant entre tradition et innovation. Il réunit des musiciennes aux goûts, qualités et expériences balayant un large spectre. Toutes formées dans la tradition classique, elles cherchent en permanence à construire une pratique musicale tournée vers la recherche et la création. Ainsi, la force créative du jazz et des musiques improvisées s’allient à l’ouverture d’esprit de la musique actuelle tout en s’appuyant sur un amour sans faille et une totale dévotion à la tradition classique.
S’inscrire dans une démarche contemporaine, au sens littéral du terme, s’imprégner et défendre les musiques d’aujourd’hui et leurs prédécesseurs, c’est l’envie du quatuor Kaija.
Embrassant l’héritage des générations d’artistes passées ou actuelles, elles sont animées par un désir de briser l’uniformisation et les balises stylistiques.
Madeleine Athané-Best
Maëlle Desbrosses
Camille Garin
Adèle Viret
Quatuor à cordes
Kaija Quatuor
•
Plus d’infos
Maximilien Ken
•
Plus d’infos
L’installation réunit plusieurs formes d’écritures et de traces poétiques. Deux poèmes sont présentés en sérigraphies grand format : Xénogenèse, publié dans La Gazette Déviante en mai 2025, et un poème sans titre paru dans Baragouine en juin 2025 autour du thème de la nature.
À ces textes s’ajoute un accrochage de sous-vêtements brodés d’une lettre d’amour extraite de l’incipit de Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, œuvre pionnière dans la lutte pour les droits trans et lesbiens. La traduction française, éditée par Hystériques et Associées et à laquelle a contribué Noémie Grunenwald, inscrit ce geste dans une filiation littéraire et militante.
Le projet s’accompagne également d’un zine collaboratif, conçu avec Jeanne Bouchet (jano), mêlant écritures, dessins et expérimentations hybrides. Enfin, des reproductions aux crayons de couleur des ouvrages littéraires qui ont nourri et continuent d’habiter le processus créatif viennent compléter cet ensemble.
Amalé Kouchelevitch (pseudonyme : amalé), a 24 ans et habite à Bruxelles depuis quelques années.
Il n’a jamais eu de formation scolaire, n’a aucun pied dans le monde de l’écriture ou de l’édition et croit en la complexité des regards qui n’ont pas été façonnés par un chemin encadré.
Il articule ses projets autour de questions politiques en lien avec son identité.
Ses travaux revendiquent une identité radicale, transgenre et lesbienne, et sont voués à pousser à la réflexion en éradiquant toute distance avec un propos politique.
Il aime écrire de la poésie shlag, empreinte d’egotrips futuristes qui flirte avec la surpuissance et qui ne s’excuse devant rien.
Xénogenese
Amalé Kouchelevitch
•
Plus d’infos
Cette installation explore la transformation des matériaux et des usages. Constituée de fragments hétérogènes — céramique, plastiques, résine, fil de fer et objets chinés — elle prend la forme d’un objet hybride, entre sculpture et meuble secret.
À la fois étrange et familier, elle joue des ambiguïtés : carillon improvisé, instrument sonore, bibliothèque de ressources. L’œuvre se veut vivante et participative : en son sein, les visiteur·euse·s découvrent des papiers, flyers ou traces à emporter.
En réunissant l’artisanat, le recyclage et l’expérimentation, ce projet interroge notre rapport aux objets du quotidien et ouvre un espace de jeu, de curiosité et d’échange.
Artiste visuelle et performeuse basée à Paris, Dahlia Koum Sam forge une œuvre profondément enracinée dans les rituels, vibrante de politique et habitée par une esthétique envoûtante. Formé·e aux Beaux Art de Paris et à la Villa Arson, elle s’est rapidement détourné·e des formats institutionnels classiques pour imaginer un art revivifié, incarné et émancipé des cadres muséaux figés.
En 2023, iel fonde la House of Deathless Flowers, laboratoire queer, magique, hybride et politique, dédié à la création, au soin et à l’expérimentation artistique. Cet espace inédit est inauguré par l’exposition « Nous voulons chanter pour les fées aux yeux rouges », manifeste poétique et onirique où se conjuguent écologie, mémoire queer, luttes féministes et magie décoloniale.
À travers installations, performances, dessins, textes et dispositifs hybrides, Dahlia construit des îlots de résistance poétique, des cocons sensoriels où se conjuguent réenchantement d’objets du quotidien, spiritualité collective, transformation des récits et célébration des identités marginalisées. Elle donne ainsi une voix aux fées, aux corps déviants, aux marges et aux savoirs occultés.
Cette démarche critique et poétique dépasse l’ambition esthétique : il s’agit de créer des formes vivantes, ouvertes, capables de réactiver les pratiques ancestrales, sorte de cocons réveillant les imaginaires et inventant d’autres façons d’exister. Physique autant que spirituelle, l’œuvre de Dahlia est une invitation à traverser les seuils, à se réapproprier le monde par le biais du rituel, de la métamorphose et de la communauté.
Présentée dans des espaces indépendants, des lieux queer, des cercles de création alternatifs et en lien avec des communautés militantes, sa pratique affirme l’urgent besoin d’un art habité enraciné, collaboratif, enchanté.
PEACE ON THE WORLD PT1
Dahlia Koum Sam
•
Plus d’infos
À mes yeux, avant d’être cette usine monumentale ancrée dans le paysage de La Boissière, Mozinor à d’abord été, pour mon moi adolescent, une figure iconique du paysage internet français. Un mystérieux personnage au visage masqué grimaçant les traits d’un Fantômas grotesque avant tout incarné par une voix multiple se réappropriant le cinéma et la télévision pour les tourner en dérision.
Pour moi, Mozinor résonne avant tout à travers l’image d’un « 007 tu peux pas test » jouant avec sa boîte à Lambert et roulant des bedos longs comme le bras.
Et toute une génération de montreuillois·e·s aura la réf, tout les OG auront la réf, et je ne doute pas que, comme moi, nombre de mes camarades d’école de l’époque auront au fil des années découvert que Mozinor est plus qu’un personnage satirique, mais une entité architecturale intrinsèquement reliée à la ville. Montreuil Zone Industrielle NOrd.
Ainsi, de la même manière que Mozinor aura su rendre hommage à la ville à travers son choix de pseudonyme, j’aimerai lui rendre hommage avec une installation sculpturale à son effigie sur le toit de l’usine. Un hommage à une figure historique de la commune. Un hommage à la commune elle-même donc.
Photographe-Plasticien diplômé des Beaux-Arts de Paris depuis 2020, le travail de Maxime Laguerre s’inscrit dans la volonté de développer une pratique interdisciplinaire à partir de recherches documentaires sur l’identité et le post-colonialisme. Des notions inscrites dans son œuvre du fait de son métissage et de son appréhension du monde en tant que créole afro-descendant.
Son histoire personnelle prend place entre l’Europe et l’Afrique, suite à la colonisation française et au commerce triangulaire. Une histoire faite de fragments. Fragments qu’il réunit à travers photographies, textes et objets, à la fois pour recomposer son identité, mais aussi pour partager histoire et références personnelles.
Sa recherche artistique s’est tout d’abord orientée autour de concepts tels que la « Négritude » d’Aimé Césaire et la « Mondialité » d’Edouard Glissant, deux figures qui l’inspirent en tant que vecteurs d’ouverture au monde et de transmission. Depuis, son travail plastique n’a de cesse d’absorber la culture qui l’entoure comme le cinéma, la musique, la radio et la littérature.
Aujourd’hui assistant pour l’artiste Anselm Kiefer, il a réussi à se soustraire à un certain déterminisme social pour se donner les moyens de continuer à s’investir dans une pratique artistique prenant source dans la photographie argentique et les techniques d’impression pour se présenter au monde sous la forme d’objets photographiques.
Hommage à Mozinor
Maxime Laguerre
•
Plus d’infos
Le travail d’Héloïse Laïla Lagarde explore la voix comme matière à habiter. À travers des objets en céramique chantables, des performances immersives et des installations vibratoires, elle interroge la manière dont le son, qu’il soit chanté, modelé ou résonné, peut devenir espace, mémoire et soin.
Chaque œuvre est pensée comme un satellite : mobile, poreuse, activable. L’artiste imagine ainsi des refuges sensibles où souffle, corps et matière dialoguent. Ses créations invitent à habiter un territoire de lenteur et de vibration, non pas par les murs mais par la voix, l’onde et la porosité. Comme une cosmogonie intime, où l’écoute partagée rencontre la géographie intérieure.
Performance chantée avec sculpture en céramique
Héloïse Laila Lagarde
•
Plus d’infos
MACIEK LASSERRE MCK [S] + BOXCREW (BATTLE HIP HOP EXP)
Création rap-électronique et danse hip-hop. Rencontre entre le collectif de danse montreuillois BOXCREW et le saxophoniste et compositeur Maciek Lasserre pour une battle hip-hop expérimentale.
INSTANT ORCHESTRA + SABAR
Grand Ensemble du département jazz du conservatoire de Montreuil dirigé par le saxophoniste Maciek Lasserre, consacré à la pratique collective de la composition, de l’improvisation et à l’exploration du territoire fin situé entre oralité et écriture.
Pour cette occasion ils inviteront la classe de sabar du conservatoire du 7ème arr de Paris dirigée par le percussionniste Ivan Ormond et Mor Junior Ndiaye Rose percussionniste, griot et petit fils de l’illustre Doudou Ndiaye Rose.
Maciek Lasserre est coprogrammé par le Conservatoire de Montreuil & Est Ensemble
Maciek Lasserre :
Musicien à la créativité singulière, il évolue sur la scène parisienne et internationale avec des projets de jazz contemporain et de rap expérimental.
De 2001 à 2010, il participe à une série de tournées notamment en Afrique (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Maroc, Tunisie) et en Europe.
En 2006, il part étudier la musique de Steve Coleman à New-York. Il y découvre la scène avant-gardiste new-yorkaise avec Steve Lehman, Vijay Iyer et Tyshawn Sorey.
De retour en Europe, il intensifie son travail d’écriture et développe le MCK Projekt à travers lequel il formalise les concepts clés de sa vision musicale, esthétique et philosophique.
En 2015, il co-fonde le groupe Sélébéyone (Pi Recording) avec le saxophoniste et compositeur Steve Lehman, le lyriciste américain HPrizm (Antipop Consortium) et le rappeur sénégalais Gaston aka Bandimic.
En 2020, il est à l’initiative des A.M.E (Atelier de Musiques Exploratives) en collaboration avec le musicien, activiste et philosophe brésilien Fred Lyra.
Son parcours l’a amené à collaborer avec des artistes tels que : Magic Malik, Steve Lehman, Olivier Sens, Chander Sardjoe, Alain Vankenhove, Jozef Dumoulin, Karim Ziad, Brice Wassy, Doudou Ndiaye Rose, Ablaye Mbaye, Thionne Seck, Hamid Bouchnak, DaBrains, Gaston Bandimic, HPrizm (Antipop Consortium), Mike Ladd, Disiz La Peste, Souffrance, Oxmo Puccino.
Il s’est produit dans des clubs à Paris, New York, Varsovie, Dakar, ainsi que dans de grands festivals internationaux : Berlin Jazz festival, North Sea Jazz Festival, Ecstatic Music Festival New York, Paris Jazz Festival, Festival Gnawa d’Essaouira, Frankfurt Jazz Festival, Francofolies de la Rochelle, Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde…
Maciek Lasserre est aujourd’hui très actif sur le plan pédagogique (CRD Montreuil) et dans le développement du MCK Projekt et de ses ramifications : MCK [S] et A .M.E Atelier de Musiques Exploratives.
Concert
Maciek Lasserre
•
Plus d’infos
François Lecoq est formé à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, institution renommée pour son approche du mouvement, du corps et de l’espace scénique. Héritier de cette pédagogie, il développe une pratique où l’attention portée au geste, au rythme et à l’improvisation occupe une place centrale. Son travail explore les zones de rencontre entre théâtre, performance et arts visuels, en privilégiant toujours une approche sensible de l’espace et du collectif. À travers ses créations, il met en jeu le rapport entre le corps et l’environnement, entre la mémoire et la fiction, entre l’intime et le partage.
François Lecoq joue une partie d’échec sur l’installation Dédale et Alchimistes de Véronique Bourgoin et Jeanne Susin pour la musique. Cette performance reprend le concept d’une action initialement réalisée par Véronique Bourgoin en 2019 au New Museum, dans le cadre de Performa, pour le projet de Raymond Pettibon Whoever Shows: Strike Up th’ Band!
En 2025, Véronique Bourgoin invite François Lecoq à en proposer une nouvelle activation à Mozinor, dans le cadre du projet Dédale et Alchimistes, accompagnée d’une musique originale composée par Jeanne Susin.
Vêtu d’un t-shirt imprimé des pantones du Tableau périodique des éléments usuels, un homme joue aux échecs avec un chien en peluche, Buster Raymes, portant un masque 3D customisé sur lequel défile un message. Les pièces du jeu d’échecs sont remplacées par des flacons de couleurs « dangereuses ».
L’action se déploie en dialogue avec la pièce sonore Un fantôme dans mon ordi v4. Cette performance s’inscrit dans la continuité du projet de Véronique Bourgoin autour du Tableau périodique des éléments usuels.
Performance sur Dédale et Alchimistes
François Lecoq
•
Plus d’infos
Le coeur
Au sommet du tronc tronqué, la tranche avec ses soixante quinze cernes. C’est la coupe d’un Paulownia, l’unique arbre où le Phénix daigne se poser.
Une moustache de chat est cachée à l’intérieur.
Le coeur est peint par Alissa Mitzkewitch
Le cerveau
Au sommet du tronc tronqué, la tranche avec ses onze cernes.
C’est la coupe d’un Albizia julibrissin, l’arbre à soie aux racines envahissantes.
Une moustache de chat est cachée à l’intérieur.
Les impressions des images de Jean-Louis Leibovitch ont été réalisées par Prestimage.
Jean Louis Leibovitch est photographe plasticien, né à Paris en 1950.
Il vit et travaille à Montreuil.
Difficile de catégoriser le parcours de Jean-Louis Leibovitch. Passé par les Arts Appliqués, ce photographe plasticien s’est créé un univers onirique qui reste étrangement concret.
Il est notamment l’associé de l’école expérimentale de l’Atelier Reflexe, créé par Véronique Bourgoin et Juli Susin et du projet éditorial Royal Book Lodge.
Parallèlement à son travail de photographe il développe une activité de fac-simileur et de « faussaire officiel », il travaille notamment pour Le Musée National de l’Histoire de l’Immigration depuis sa création, pour le Centre des Monuments Nationaux, la Mairie de Paris, le Musée de l’Homme et le Musée Yves Saint Laurent.
« Avec ses images, Jean-Louis Leibovitch tord le cou aux catachrèses, prenant au pied
de la lettre ces métaphores devenues inertes, par exemple la barrière de la langue. Il rappelle le
lien avec la chose qui étendait leur sens, sans toutefois les reconnecter avec la signification
d’origine, puisqu’il procède par association, créant de nouvelles liaisons plus évocatrices. En
devenant fil de fer barbelé, la barrière évoque quantité de choses bien plus dramatiques et
inquiétantes qu’une simple incompréhension ou un déficit de traduction.
Son travail photographique me fait penser au processus d’exaptation théorisé par Stephen
Jay Gould pour remettre en cause l’hyper-adaptionnisme des biologistes après Darwin.
Ceux-ci pensaient que chaque organe avait été sélectionné parce qu’il avait une utilité. Selon
le paléontologue, la vie opère souvent plutôt par détournements, subversions, recyclages.
Les mots-images de Jean-Louis Leibovitch, sous forme parfois ludique ou de machine à
inquiéter, détournent les choses de ce qu’elles devraient figurer ou signifier en leur donnant
un autre contexte.
Les mots-images font éprouver ce qui se condense, s’évoque, se dit sans se dire, comme une
boîte à plusieurs fonds. Comme un mot qui aurait quantité de significations toutes vraies et
justes. Comme une histoire dont la surface bruisse des dizaines et des dizaines d’époques
qu’elle charrie, dont il sait convoquer les puissances. »
– Vinciane Despret, Montreuil 2021
Le cœur / Le cerveau
Jean-Louis Leibovitch
•
Plus d’infos
« Il arrive que l’absence de guide d’utilisation dans le package décontenance
Pas de tuto. Sans concession, une immersion perplexe et convexe dans une œuvre. Ni envers-dévers, pas de dimension, que de la distorsion.
Le mouvement a déserté, les araignées se sont cachées.
Les forêts à demi-mortes se domestiquent de plastique. Et la résine envahit la résine.
Ne reste plus qu’à chercher entre les dé-formes l’illusion d’un sens, par tous les angles.
À l’intérieur du vertige. » — Clémence Carel
Mona Lemaire développe une pratique sculpturale et spatiale qui interroge les manières de percevoir, d’assembler et de détourner les formes du quotidien. À travers la déconstruction d’objets collectés puis réassemblés, elle génère des figures hybrides, à la fois objets, images et architectures, qui rejouent les codes de la perspective et du volume dans une logique de torsion. En perturbant les repères spatio-temporels, elle fabrique des environnements ambigus, où les objets deviennent des énigmes visuelles : trompe-l’œil architecturaux, puzzles perceptifs, formes en tension.
Son travail se construit dans un va-et-vient entre l’objet physique et son image, explorant les potentialités de la sculpture, du dessin, de la modélisation numérique et de l’impression textile. Elle compose des environnements où les techniques manuelles rencontrent les outils numériques, et où la scénographie agit comme une extension du geste sculptural. Ce croisement des pratiques lui permet de repenser les frontières entre l’image, la forme et l’espace.
Ancrée dans une réflexion sur la lecture des espaces construits et des systèmes de vision, sa démarche convoque des références croisées à l’histoire de l’art, à l’architecture, au design et à la fiction. Elle vit et travaille à Paris.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Quand on doit vivre caché, les fantômes apparaissent le jour / Apparaissent le jour
Mona Lemaire
•
Plus d’infos
Sophie Loubaton est une photographe française dont le travail explore les liens entre portrait, mémoire collective et engagement social. Depuis plusieurs années, elle développe une pratique attentive aux récits intimes et aux visages de celles et ceux que l’on voit peu dans les représentations dominantes. Son regard, à la fois tendre et précis, capte des instants de vie qui révèlent autant la singularité des personnes que la force de leurs histoires partagées. Dans cet esprit, elle produit des reportages construits, articulant photographie, écriture, parole, prise de son, autour de thèmes privilégiés tels le monde du travail, la solidarité, l’éducation, la ville et ses mutations, le paysage…
Lauréate de la Grande commande photojournalisme pilotée par la BnF, ses travaux font l’objet de publications : Regards, Le Monde, Télérama, Politis…, d’expositions : Bibliothèque nationale de France, Galerie Fait&Cause, Maison de la Culture d’Amiens, Musée d’Art Contemporain de Genève, La Villette, Fête de l’Humanité… Elle vit et travaille à Montreuil (93).
Dans le cadre de Label Gamelle, coopérative de restauration et d’insertion située à Montreuil, partenaire de Mozin’Arts, Sophie Loubaton a réalisé une série de portraits sensibles des salarié·es de la structure. Ces photographies, conçues comme des diptyques, associent image au travail et image personnelle, offrant à chacun·e la possibilité de se raconter tel qu’il ou elle le souhaite. Ce projet collectif met en lumière la dignité, la créativité et l’humanité des personnes engagées dans ce circuit court de solidarité.
Les Diptyques de Label Gamelle
Sophie Loubaton •
Plus d’infos
Lou et Damien performent des chansons improvisées aux confins de la pop.
Iels tissent une toile immatérielle aux couleurs changeantes où l’émotion est exacerbée par les modes de
jeux étendus et électroniques.
Lou crie, chuchote, tempête, et berce les imprévus virtuels que Damien crée avec sa guitare cyborg.
C’est la chanson qu’on essaye d’écouter sur un cd rayé.
Iels proposent des reflexions sur le temps qui passe et les choses qui changent,
sur les drapeaux que l’on brandit.
Lou et Damien est un duo éclectique et poétique, mélancolique et parfois extatique.
Lou Ferrand chante, écrit et compose. Elle explore les frontières mouvantes des musiques actuelles, tant dans la scène du jazz ou de la musique contemporaine que dans les chansons. Ses inspirations sont Sofia Jernberg, Björk, Ingrid Laubrock et Adrienne Lenker. Portée par une curiosité musicale insatiable, elle navigue entre compositions originales et réinterprétations sensibles, en mêlant les langues et les paysages sonores. La performance devient un espace d’écoute, de jeu et de risque, où le souffle et le silence trouvent leur place aux côtés du verbe et de la ligne mélodique.
Dans les diverses formations auxquelles elle prends part comme un autre duo avec Liam Szymonik ou dans le quartet de pop noise Nit&Dogs lauréat de Jazz Migration #11, Lou Ferrand défend une approche vivante et engagée du chant, à la fois intuitive et intellectuelle, au croisement des formes écrites et de l’improvisation libre. Elle approfondit ses recherches formelles et sonores auprès de Lynn Cassiers et Pierre de Bethmann au CNSMDP.
Damien Thonnard est un guitariste et compositeur d’origine belge. Depuis toujours, il s’attache à construire, déconstruire puis reconstruire le son. Curieux, il explore un vaste éventail de styles musicaux, intégrant chaque influence à son esthétique personnelle et à ses compositions. De l’énergie brute du rock à la liberté du jazz — qu’il soit traditionnel, contemporain ou free —, en passant par la poésie des chansons traditionnelles, jusqu’aux textures de la musique électronique, chaque univers lui ouvre de nouvelles perspectives
Damien prend part au groupe Pyrizein, avec lequel il revisite des morceaux traditionnels siciliens. Parallèlement, il fonde son propre ensemble, La Messagerie des Cieux, où toute la musique naît de l’improvisation. Il développe également un répertoire de chansons slovaques en collaboration avec la chanteuse Eva Miškovičová. Par la suite, il s’investit dans plusieurs projets aux esthétiques contrastées, parmi lesquels Rec1_Sat1_, aux influences pop et groove, et HÜBLÒ, formation de jazz/punk expérimental. Des projets aussi différents les uns que les autres, à l’image du parcours musical de Damien Thonnard.
Pour Damien, toutes ces musiques partagent une question essentielle : Comment organiser l’interaction entre musicien·nes de façon à ce qu’elle devienne un véritable processus créatif?
Concert
Lou & Damien
•
Plus d’infos
Naine rouge, suspendue, donne une lecture verticale de l’espace, instaurant une douce tension entre gravité et légèreté. Naine brune, plus compacte, ancre la composition dans une dynamique plus horizontale, tournée vers le jardin. Le spectateur circule entre ces deux pôles, comme en orbite autour d’un axe invisible. La tour d’aération devient un point nodal, un pivot entre deux formes d’étoiles, deux manières d’habiter le ciel.
Ces sculptures cherchent à entrer en résonance avec la plasticité du lieu : textures, couleurs, lignes de force. Elles s’ancrent dans un équilibre entre installation et architecture, entre poésie et clin d’œil à l’histoire politique du lieu, entre utopie et gravité.
MAJ est un collectif composé de Margot Lacombe, Amélie Cooper et Jessica-Phoëbe Mulindahabi. Il est né en mars 2025 au Salon Cinqcinq, où les trois artistes partagent leurs ateliers. MAJ est un collectif pluridisciplinaire : il réunit deux peintres et une sculptrice, les artistes pratiquent la peinture, sculpture, céramique et vidéo.
Naine Brune et Naine Rouge
Collectif Maj
•
Plus d’infos
Nure-onna (2024) est une sculpture fragmentée en céramique qui fait référence au yōkai du folklore japonais qui ressemble à une créature amphibie avec la tête d’une femme et le corps d’un serpent. La figure de la femme serpent de diverses mythologies est récurrente dans la pratique d’Alix Marie.
Pumping Heroes est un ensemble de sculptures gonflables extraites du projet Shredded dans lequel Alix Marie explore la performance de la virilité dans le culturisme et les tensions des constructions sociales de la masculinité aujourd’hui. A travers les différentes oeuvres de ce corpus, elle retranscrit ses recherches sur les relations entre culturisme et Histoire de la photographie et du cinéma, aussi bien qu’avec l’Histoire de sculpture et la mythologie Grecque.
Alix Marie (née à Bobigny en 1989), est une artiste pluridisciplinaire dont le travail mêle principalement photographie, sculpture et installation. Elle est diplômée du Central Saint Martins College (2011) et du Royal College of Art (2014) de Londres. Son travail explore notre relation au corps et sa représentation à travers des procédés d’objectification, de fragmentation, d’accumulation et d’élargissement. Le questionnement de la construction du genre se mêle à l’autobiographie et la mythologie afin de construire des expériences poétiques et viscérales.
Nure-onna / Pumping Heroes
Alix Marie
•
Plus d’infos
Nous revenons en cette saison automnale pour une nouvelle expérience. Une nouvelle création d’édifice, celle-ci se passera à Mozinor, un ancien bâtiment industriel prêt à lier son histoire à la nôtre.
La définition de cette collection se base sur ma folie. Des formes triangulaires, véritables symboles de mon art, s’accompagnent de lignes épurées pour sublimer le corps.
Après mon premier défilé, GAÏA, mon seul but était de perpétuer cette recherche personnelle, casser, changer et apporter ma définition du vêtement.
Je vise un retour à l’essentiel, tout en disant « vous portez du MÉNARD, donc vous portez un vêtement ».
Cette démarche explique pleinement les valeurs que la marque représente, minimalisme, singularité, élégance contemporaine et inclusivité.
J’ai à cœur de porter des messages à travers chaque défilé, pour des causes qui me touchent mais qui nous touchent tous en réalité.
Ménard ne serait rien sans votre soutien mais également celui de mon équipe : Celia , Anissa , Ling et Francis.
Défilé MENARD SS26
Alioune Menard
•
Plus d’infos
Improvisation libre : paysages sonores et piano
Lucie Mesuret est urbaniste et réalisatrice radiophonique. Son travail consiste à élaborer des narrations des territoires dans le montage des différents témoignages récoltés, sous la forme de création sonore et de BD documentaire. Elle travaille sur les thématiques de l’habiter, du lieu et de la disparition : comment on habite les lieux, pourquoi on est contraint de les quitter et comment on traverse leur disparition. Son travail porte sur la dimension mnésique des lieux et sur l’expérience vécue et perçue dans les espaces que l’on vit au quotidien. Elle s’intéresse particulièrement à la condition des locataires en logement social, qui subissent des opérations publiques de transformation urbaine et sont souvent contraints à quitter les lieux qu’ils habitent. Elle réalise également des ateliers d’écoute active du paysage sonore qui s’intéressent à la notion de qualité environnementale des espaces urbains et ruraux, et des compositions musicales de paysages sonores (fieldrecording ou soundscaping), sous forme d’installations sonores ou de lives d’improvisation libre où se mêlent piano, électro-acoustique, et voix. Lucie Mesuret a co-fondé Les Eclisses avec Camille Boisaubert, designer et graphiste.
Concert
Lucie Mesuret
•
Plus d’infos
Le projet iCloud Error: The last backup could not be completed est une installation immersive qui invite le visiteur à émerger dans un espace-archive où l’identité, la mémoire et le temps se dissolvent dans un nuage numérique. Elle réunit huit peintures à l’huile et une constellation d’objets intimes : verres brisés, pages arrachées de cahiers, journaux personnels, chaussures, ailes fracturées, téléphones aux écrans fissurés.
Au cœur du projet se trouve une réflexion sur la notion d’immortalité numérique, où chaque instant de vie est téléchargé dans un nuage de données intangible et infini. Mais c’est précisément dans cette tentative de tout conserver que la mémoire perd son authenticité.
Les peintures deviennent des fragments de souvenirs volontairement dégradés, comme des fichiers numériques compressés de basse qualité, tandis que les objets personnels apparaissent comme des traces de corporalité et de présence — preuves d’une existence physique avant le « téléchargement de la conscience ». Ils sont les témoins fragiles d’une tentative de retenir une présence qui se dissout dans le flux de réseau, où chaque émotion devient un fichier, voué à la distorsion. Ensemble, ces éléments composent une archive imparfaite et fuyante, une dernière sauvegarde de ce que nous avons été. L’installation interroge le paradoxe de l’héritage numérique : les souvenirs perdent-ils leur essence lorsqu’ils deviennent infiniment reproductibles ? Peut-on se fier à une copie de soi, si l’inconscient se transforme en fichiers illisibles et les souvenirs — en pixels compressés ?
Et surtout : qu’aimerions-nous sauver à tout prix, sachant qu’il s’agit de la dernière sauvegarde de notre identité ?
Alissa Mitzkewich est une artiste pluridisciplinaire qui explore les frontières entre beauté et destruction. Titulaire d’un diplôme en animation 3D (Bachelor) et d’un Master en management des projets dans l’industrie créative et concept art, elle fusionne techniques numériques et traditionnelles pour créer un langage artistique singulier. Son parcours professionnel couvre divers domaines créatifs : graphiste, designer 2D, artiste et animatrice 2D. Elle enseigne également le dessin et le design à l’Université des sciences humaines et de technologie de Moscou et à l’Institut d’architecture et de génie civil de Moscou (MGTU-MASI).
La peinture d’Alissa Mitzkewich examine la tension entre la perception humaine du réel et les technologies, abordant des thèmes tels que l’anxiété, l’aliénation et la désintégration de l’identité. Malgré la noirceur sous-jacente de ses œuvres, celles-ci sont exécutées dans des couleurs vives et saturées, qui transforment la dureté du monde en une expérience visuelle envoûtante. Ce paradoxe incite le·a spectateur·ice à s’arrêter, réfléchir et reconsidérer sa propre perception du monde contemporain.
Au-delà de la peinture, ses œuvres intègrent des fragments de poésie dissimulés dans les couches de peinture à l’huile — des bribes de texte révélées par une observation attentive. Cette fusion de l’image et du langage ajoute une profondeur narrative, invitant à une lecture plus intime de l’œuvre. L’utilisation de cadres distordus imprimés en 3D élargit le champ de la toile traditionnelle en y apportant une dimension sculpturale. En confrontant l’artisanat manuel à la technologie, Alissa Mitzkewich interroge les notions d’authenticité, de contrôle et de perception humaine dans un monde de plus en plus gouverné par les algorithmes.
iCloud Error: The last backup could not be completed
Alissa Mitzkewitch
•
Plus d’infos
Der Sammler (2025), 6 min.
Mettre en jeu sa vue, au risque de perdre son temps. Chez le collectionneur, impossible d’en gagner. Sous la mécanique mystérieuse de l’horloge se joue une partie qui donne sa fin d’entrée de jeu. L’échiquier s’étire là où penche sa faveur. (Perdre et être défait.) La joueuse dupée refuse la supercherie, l’injustice et l’image qu’ose lui renvoyer le miroir de son visage mutilé. Contre la dépossession, pour interrompre la chaîne de la vision promise à un homme à l’envers, orchestrateur probable, il reste à rediriger son propre insoutenable fragment d’image contre le corps scandaleusement indemne. Remettre en jeu sa vue, au risque d’être à court de temps.
Distribution (dans l’ordre de l’apparition) :
Joueur 1 : Jean-Louis Leibovitch
Der Sammler : Fabrizio Bonachera
Joueur 2 : Maya Mkarem
L’Homme à l’envers : Mirron Mitzkewich
Mirron Mitzkewich : réalisateur, scénariste, directeur de la photographie
Titouan Hamonic : directeur de la photographie, monteur
Juli Susin : producteur (RBL), accessoiriste
Matéo Aureille : maquilleur, coiffeur
Salahina Coulibali : technicien effets spéciaux
Mirron Mitzkewich, né à Moscou en 2000, a quitté la Russie en 2018 et est devenu réfugié politique en 2024. Il vit et travaille à Paris, où il a obtenu une licence en cinéma et audiovisuel à l’Université Paris 1 en 2022.
Depuis 2018, il a réalisé et co-réalisé plusieurs courts métrages expérimentaux en numérique et Super 8. Depuis 2022, Mirron Mitzkewich collabore avec la musicienne et compositrice Jeanne Susin sur des vidéos et des captations live. La même année, il débute une collaboration avec Royal Book Lodge, pour le montage d’archives vidéo et la production de nouveaux enregistrements d’expositions et de performances. En 2023, il a travaillé au montage et à la réalisation partielle du film Chronos-Swimmer de Juli Susin et Raisa Aid, présenté au Musée des Abattoirs de Toulouse. En 2024, il co-réalise le court métrage Summoning avec Juli Susin. En 2024, il présente une installation audiovisuelle Alienum Corpus pendant la première édition de Mozin’Arts, qui vise à retranscrire des expériences personnelles de transition de genre et d’exil, menant une réflexion sur l’aliénation dans son propre corps et dans le monde. En 2025, il co-réalise le court-métrage Der Sammler avec Titouan Hamonic.
Titouan Hamonic est doctorant en études cinématographiques à Paris 1. Il réalise depuis 2017 des courts-métrages expérimentaux dont un diptyque en found footage intitulé 36°N / 115°O, en dialogue explicite avec ses préoccupations théoriques, questionnant la possible atmosphérogénéité des images en mouvement et le sentiment qu’elles visibilisent de leur monde propre. Son intérêt conjoint pour l’ambient se retrouve dans ses contributions musicales minimales aux créations vidéo auxquelles il se joint, collaborant à de nombreuses reprises au cadre et montage de courts co-réalisés avec Mirron Mitzkewich depuis 2019, ainsi qu’avec Juli Susin depuis 2023. Il figure la même année dans Summoning, film co-réalisé par Mitzkewich et Susin, contribue à sa post-production, et monte Paris-Est de Juli Susin, film longtemps resté inachevé et finalement montré en 2024. Der Sammler, en 2025, marque sa dernière collaboration en date avec Mirron Mitzkewich.
Der Sammler
Mirron Mitzkewitch & Titouan Hamonic
•
Plus d’infos
Variété catastrophe
Chanteuse de sous-sol, Orphée plaide pour une musique libre. Improvisatrice de métier, son truc, c’est de ne rien prévoir. Armée seulement de sa pédale looper et d’un synthé-jouet, elle fera de son mieux pour vous faire plaisir – à coups de boîtes à rythme et de basses électroniques. Soyez indulgent·e·s ! Bravant le vertige, elle sautera dans le vide, pour y ramasser de vieilles paroles rêvées. Entre la blague et le drame, vous pourrez avec elle danser… Ou pleurer. Pour l’amour de l’erreur, et des femmes dites hystériques. En avant la musique !
Concert
Orphée aux Enfers
•
Plus d’infos
Méduses de verre : un dialogue entre restauration et création
Depuis deux ans, Célestine Ousset restaure pour le Musée zoologique de Strasbourg les modèles en verre des invertébrés marins créés par les célèbres verriers Leopold et Rudolf Blaschka au XIXe siècle. Ces œuvres, à la fois scientifiques et artistiques, ont marqué l’histoire des collections naturalistes par leur précision et leur beauté. Immergée dans l’univers fragile et poétique de ces pièces, elle en a tiré une source d’inspiration majeure pour son propre travail de création.
Son projet actuel, « Méduses de verre », est une exploration artistique et technique du verre filé et soufflé, où elle réinterprète la grâce évanescente et la complexité organique des méduses. Ces créatures marines, souvent symboles de transparence et de mouvement, deviennent sous ses doigts des sculptures délicates, à la frontière entre science et art. Chaque pièce est le fruit d’un dialogue entre le savoir-faire ancestral du verre et une approche contemporaine de la matière, mêlant rigueur artisanale et liberté créative.
À travers cette série, Célestine Ousset interroge les liens entre mémoire, fragilité et métamorphose. Les méduses, organismes à la fois résistants et éphémères, incarnent une réflexion sur la préservation du patrimoine – qu’il soit naturel, scientifique ou artistique. Son travail s’inscrit ainsi dans la continuité de sa pratique de restauratrice, où la compréhension intime des matériaux et des techniques historiques nourrit une démarche artistique résolument actuelle.
Célestine Ousset est restauratrice du patrimoine, spécialisée dans les arts du feu (céramique, verre, émail), diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en conservation-restauration (2003) et en conservation préventive (2010). Depuis plus de vingt ans, elle collabore avec des institutions muséales, tout en nourrissant une pratique artistique personnelle profondément inspirée par les objets qu’elle restaure. Ces pièces, porteuses d’histoires et de traces, deviennent le point de départ de ses créations, où elle explore la mémoire, la fragilité et la résilience des matériaux.
Son travail plastique, centré sur le verre filé au chalumeau et la céramique, s’envisage comme un dialogue entre passé et présent, entre geste artisanal et recherche contemporaine. Elle y mêle rigueur technique, attention aux formes résiduelles et sensibilité aux récits silencieux que recèlent les matières.
Engagée dans la transmission depuis plus de dix ans, elle partage son savoir avec les étudiants restaurateurs de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, perpétuant ainsi une approche à la fois scientifique, sensible et créative du patrimoine.
Méduses de verre
Célestine Ousset
•
Plus d’infos
Remorque funéraire de la fin des années 50 transformée en chambre nuptiale, abritant pour l’occasion un célèbre couple médiatique sur l’invitation de Véronique Bourgoin.
Satyre de mariage sur fond de géo-politique contemporaine.
Véhicule tracteur Fiat Belvedère Abarth Break à l’intérieur duquel sont installés deux attachés-case invitant le spectateur à la réflexion.
Gilles Perez de la Vega, artiste plasticien, décorateur, également sculpteur et collectionneur de micro véhicules des années 50 et 60. Une partie de son travail artistique est de concevoir et réaliser des pièces uniques alliant sculpture, installation et design.
Love Teardrops est un concept évolutif développé depuis quelques années autour des micros-caravanes qui ne sont autres que des lits carrossés traités en chambres d’amour thématiques et mobiles. Créées sur des bases existantes ou construites de toutes pièces, sortes de sculptures fonctionnelles, elles trouvent leur place aussi bien au milieu d’un loft que dans un jardin.
Une invitation au voyage, au voyage dans le temps, aux « transports amoureux » et à la volupté.
Il s’agit en quelque sorte d’une transposition de l’image conditionnelle de la caravane en un écrin ouaté, une sorte de malle-cabine améliorée et dédiée aux plaisirs raffinés de l’amour et du voyage, qui ici, est à prendre au sens le plus large.
Gilles Perez de la Vega met en scène ces caravanes, décorées dans l’esprit des somptueuses chambres à thèmes de la grande époque des maisons closes, Chabanais, Sphinx, One Two Two, mais aussi des Love Rooms contemporaines. Un juste milieu entre installation artistique et patrimoine automobile.
The Wedding / Love Teardrops IV
Gilles Perez de la Vega
•
Plus d’infos
Poèmes pour une musique dépouillée.
Ça parlera de fugues, de l’aide sociale américaine, de miséricorde, de boussole.
Au cours de ses études (Licence de musicologie à Paris-Sorbonne, CFEM d’analyse classique, DEM de batterie, DEM de Formation Musicale, CNSM de Paris), Thibault Perriard se spécialise dans le jazz et les musiques improvisées, notamment au sein du collectif parisien Onze Heures Onze. Batteur des groupes Oxyd, Slugged, Phonem, il rencontre les musiciens Marc Ducret, Nelson Veras, Magic Malik, et fonde avec A.E Davy le duo chant/batterie Le Bigraphe.
Guitariste et chanteur lead du groupe TOMBOY, il signe avec P.M.Barbier les génériques de Guillaume à la dérive, Sylvain Dieuaide, et de Jalouse, David Foenkinos, nominés aux Césars 2018.
En tant que comédien et musicien, il travaille depuis 2014 en co écriture sur les spectacles de théâtre musical Didon et Énée / Le Crocodile Trompeur, (Candel, Achache) Molière 2014 du théâtre musical ; Fugue (Achache) ; Crack in the sky (Judith Chemla) ; Orfeo / Je suis mort en Arcadie (Candel/Achache) ; Chewing-gum Silence (Achache), l’Oreille de Denys (Candel), Le Bigraphe (Davy) ; Alabama Song (Barbot) ; Concerto contre Piano et Orchestre (Achache) ; Yes (Les Brigands, Gallard, Hatisi) ; Baùbo (Candel) ; Symphonie tombée du ciel (Achache).
Il réalise la création musicale de Ce qui survit du murmure (Perriard) ; Les Analphabètes, (González, Calinoiu) ; La Nuit Sera Blanche (Gonzalez, Candel) ; Celui qui dit oui, celui qui dit non (Borvon) ; Les vagues (Vigneron) ; Welfare (Wiseman, Deliquet) nominé aux Molières 2024 et créé pour l’ouverture d’Avignon 2023 au Palais des Papes. Enfin il participe à l’ecriture d’un opéra, Les Incrédules, pour l’Opera de Lorraine avec Achache, Tri Hoang et Hubert. Sur ces spectacles, il est également performer et concepteur d’installations sonores.
Concert
Thibaud Perriard
•
Plus d’infos
Frank Perrin est un artiste plasticien qui questionne le visible. Son art explore depuis plus de deux décennies le concept de post-capitalisme, édifiant ainsi le panorama de nos obsessions contemporaines.
La série « Smash ! », faite de muselets de champagne écrasés et monumentalisés, constitue autant de traces silencieuses et cryptées de notre consommation. Ces petites « muselières », qui empêchent le bouchon de céder à la pression, évoquent nos divertissements qui libèrent juste assez de bulles pour éviter l’explosion.
Luxe fragile, liberté sous contrôle, Frank Perrin en fait le trophée muet de nos fêtes sous perfusion.
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger. Il est représenté en France par la galerie Michel Rein.
EXPOSITIONS PERSONNELLES
« Blindtest Codex » Galerie Michel Rein 22 Rue Visconti 2-27 février 2024
« Delivrance, Ruins, Holidays » Galerie Michel Rein, Paris, 23 mars-6 mai 2023
« Pray, Amore, Combat » Galerie Michel Rein, Paris, fev-mars 2022
« Archeology » Galerie Metamorphoses, Paris, 28 nov. 2019-4 janv. 2020
« Las Vegas Archeology », Mayeur Projects, Las Vegas New Mexico, Usa, 15 avr-27 mai 2017
« Empire Of Signs » Docks Artfair, Lyon, 10 septembre – 4 octobre 2015
« Empire Of Signs » Gallery Analix Forever, Geneva, 20 octobre – 30 novembre 2014
« Ruins And Archeology » Station, Beirut, 10-30 septembre 2014
« Heart Of Darkness », Analix Forever, Geneva, 15 sept.-30 oct. 2011
« Joggers », Linde Gallery, East Hamptons, Usa, 1 juill-30 octobre 2011
« Buildings, Ruins & Money », Galerie Jousse Entreprise, Paris, 4-29 septembre 2010
« Walk On The Wild Side », Gallery Analix Forever, Geneva, 23 juillet – 12 août 2009
« Models » (Postcapitalism Section 06), Galerie Jousse Entreprise, Paris, 13 sept.-08 nov. 2008
« Postcapitalism Kidnapping », Statements Gallery, Hong Kong, 16 juin-12 juillet 2008
« 6 Streets + 12 Cameltoes », Galerie Jousse Entreprise, Paris, 9 sept. – 20 oct. 2006
« Défilés + Joggers », Galerie Jousse Entreprise, Paris, 14 septembre – 30 novembre 2005
« Défilés », Galerie Jousse Entreprise, Paris, 11 septembre – 6 novembre 2004
SMASH!
Frank Perrin
•
Plus d’infos
trois vœux
Inspirée du conte La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, cette boîte en bois et métal renferme trois allumettes métalliques. Sur chacune est gravé un vœu, fragile écho au feu qui réchauffe et à l’espoir qui demeure. Trois matières s’entrelacent pour donner naissance au rêve.
ils racontent
Une installation composée de personnages découpés dans des plaques de laiton. Issus d’œuvres et de récits littéraires, ces fragments de figures se rassemblent pour donner naissance à un conte collectif, où chaque silhouette contribue à tisser une histoire commune.
El cuchillo de los enamorados
« Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato,llorando porque no salvan al amor. »
— Jaime Sabines
« Les amoureux vont comme des fous car ils sont seuls, seuls, et ils donnent tout d’eux mêmes, ils donnent, à chaque instants, ils pleurent, car ils savent que l’amour ne pourra pas être sauvé »
Le travail de Léonie Porcher travail s’apparente à celui d’une conteuse, nourrie par une pratique du dessin, de la performance et du travail du laiton. Elle tente de rendre hommage à certaines voix, à des histoires, à des récits de livres, d’œuvres, de vies qui l’ont touchée pour leur offrir de nouvelles trajectoires.
L’imaginaire devient un refuge, un pont entre le réel et le songe, un moyen d’explorer et de relier des réalités diverses. Intimement liée aux personnages qu’elle découvre dans les livres, les œuvres ou ses voyages, elle s’imprègne de leurs mondes pour les transposer dans de nouvelles mythologies.
Ses projets naissent d’images et de visions qu’elle développe instinctivement, laissant place à l’expérimentation. Le dessin reste au cœur de sa pratique, enrichi par d’autres techniques. À travers son travail, elle aspire à plonger le·a spectateur·ice dans un univers onirique où formes, textures, récits, et figures anthropomorphes s’entrelacent et envahissent l’espace.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
trois vœux / ils racontent / El cuchillo de los enamorados
Léonie Porcher
•
Plus d’infos
Né en 1961, Philippe Ramette vit et travaille à Paris. Après s’être essayé à la peinture, il détruit tous ses tableaux pour devenir sculpteur. Puis ce sont ses photos, qui transposent en image l’humour et l’étrangeté de ses sculptures, qui lui vaudront une grande notoriété. Il a exposé dans de nombreux galeries, musées ou manifestations à travers le monde : Centre Pompidou, Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Musée d’Art Contemporain de Lyon, Musée d’art et d’histoire et Mamco à Genève, SMAK Museum à Gand, Fondation Sandretto à Turin, Art Center à Édimbourg, Museum auf Abruf à Vienne Moscow house of Photography, Pera Museum à Istanbul, Musée national des beaux-arts du Québec, Toronto Photography Festival, Aichi Triennale à Nagoya, Watari Museum et Mori Art Museum à Tokyo, etc.
La pièce de Philippe Ramette est présentée par Creaform § Carrafont
Éloge de la contemplation
Philippe Ramette
•
Plus d’infos
Benjamin Remy-Gourreau travaille sur la porosité entre le réel et l’hallucination, entre l’image « vraie » et l’image imaginée, rêvée ou irréelle afin d’essayer de percevoir les liens entre la vie extérieur et notre vie psychique.
Né en 2004 et grandi à Tours, Benjamin Remy-Gourreau a passé trois ans à apprendre le métier de photographe en bac professionnel, avant d’intégrer une filière plus artistique avec les beaux-arts de Paris en 2023. Il étudie actuellement au sein de l’atelier de Valérie Jouve.
Sans titre
Benjamin Remy-Gourreau
•
Plus d’infos
Posée dans l’herbe, au ras du sol, la sculpture se donne à voir comme un fragment de terrain habité, un seuil organique. Des corps y reposent, dans un état de transformation lente, entre dissolution et fossilisation, entre drapé et effacement. L’œuvre explore cet instant suspendu où la forme s’altère sans disparaître.
Des fragments de chair, de plis, de drapés, fossilisés, tracent des lignes convergentes vers un tout. Deux corps sont encore perceptibles, enlacés ou emboîtés, tandis que d’autres formes, plus floues, suggèrent la présence d’un multiple indéfini. La mousse commence à les recouvrir partiellement, signalant un passage en cours : celui du corps vers la matière, de l’individuel vers l’universel.
Dans la valse lente d’une dernière étreinte, ces corps deviennent paysage.
Lieu n°0 : un point de recommencement, peut-être, mais aussi un sol chargé. Non neutre. Teinté. Ce sol imprime quelque chose, une étreinte, une chute, un événement. Il ne fait pas que recevoir : il garde. Certains sols gardent tout, jusqu’à la trace brûlante d’un souffle figé. Il est mémoire.
Cette œuvre interroge la mémoire, l’effacement, la violence et la régénération. C’est une stèle sans nom, un sol devenu témoin. Ces corps, devenus un, mutent. Ils ne disparaissent pas : ils restent, et marquent la terre.
Sarah est une artiste pluridisciplinaire basée à Paris. Elle alterne entre la peinture, la sculpture et la photographie. Après avoir été diplômée en BTS de design vêtement à l’école Duperré, puis d’un master en Écologie Des Arts et des Médias à Paris VIII, elle apprend la sculpture et la peinture à NYC et Paris en assistant des artistes.
Elle explore les multiples états de l’être incarné : ses cycles, ses transformations, ses hybridations. Fluctuant entre matérialité et immatérialité, ce corps transitoire, en formation, décomposition ou dissolution, devient un canal d’expression, un seuil entre différents mondes. Elle le perçoit comme un espace de passage, un territoire mouvant où se rejoue sans cesse l’idée de métamorphose. Les corps se figent ou se déversent dans les paysages, entre terre et air…
Elle se questionne : que devient la ligne ou la masse qui distingue un être d’un autre lorsque la chair se désagrège ? Comment la matière, par ses mutations et la mémoire qu’elle porte, devient-elle le support d’identités, à la fois individuelles et collectives ? Ses sujets s’inspirent notamment de visions survenues lors de sessions d’hypnose ou de transe, où se manifestent d’autres strates de perception et de réalité.
Dernières expositions :
– New born, exposition collective, Aspace gallery, Nyc, 2024.
– Ce qui reste quand rien ne tient, exposition collective, Mia Fine Art, Paris 2025.
– La Petite Collection, exposition collective, Salon NYC, 2025.
– Bastille design Center exposition collective, finaliste du prix AMMA Sorbonne,
9eme edition, 2025.
– Continuum, exposition collective de Blanco Nyc, Hamptons, 2024.
– Senior group show, Pace gallery, NYC, 2024.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Lieu n°0
Sarah Ringrave
•
Plus d’infos
Au col de la Furka en Suisse, à 2 429 mètres d’altitude, aux confins des régions habitables, enseveli sous la neige neuf mois sur douze, l’hôtel Furkablick, construit en 1893, sera, à partir de 1984 et pendant plus d’une décennie, un lieu de réflexion et de production pour une soixantaine d’artistes.
Ce laboratoire artistique fut conduit par Marc Hostettler, éditeur et galeriste des Éditions Média à Neuchâtel, qui découvre et saisit l’opportunité d’investir l’hôtel à la suite de la performance A Drop of Black Perfume de l’artiste américain James Lee Byars, à l’été 1983.
En 1984, une performance de James Lee Byars et Joseph Beuys, The Introduction of the Sages to the Alps, inaugure la première saison de Furk’Art.
Entre 1984 et 1996, une soixantaine d’artistes seront invités au Furkablick, parmi lesquels : James Lee Byars, Panamarenko, Marina Abramović & Ulay, Matsuzawa Yutaka, Guillaume Bijl, Hamish Fulton, Res Ingold, Per Kirkeby, Jean Le Gac, Daniel Buren, Ian Hamilton Finlay, Kazuo Katase, Olivier Mosset, François Morellet, Michel Ritter, Royden Rabinowitch, Stanley Brouwn, Gianni Colombo, John Hilliard, Rémy Zaugg, Christoph Rütimann, Reiner Ruthenbeck, Günther Förg, Richard Long, Anna Winteler, Monica Klingler, Rem Koolhaas/OMA, Roger Ackling, John Armleder, Terry Fox, Mark Luyten, Niele Toroni, Lawrence Weiner, Gretchen Faust, Kevin Warren, Pierre André Ferrand, Paul-Armand Gette, Jenny Holzer, Kim Jones, René Zäch, Dorothee von Windheim, Ian Anüll, Terry Atkinson, Andreas Christen, Ria Pacquée, John Nixon, Luc Deleu, Glen Baxter, Alix Lambert, Jean-Luc Manz, Roman Signer, Steven Parrino, Max Bill, Filip Francis, Christian Floquet, Mario Merz, Claude Rutault, Jean Crotti, Peter Fischli & David Weiss, Joseph Kosuth.
Depuis 2014, Thomas Rodriguez documente cette histoire en recueillant des témoignages d’artistes et de protagonistes, et en collectant les documents de communication de Furk’Art, les ephemera. Ces recherches ont abouti à la publication du livre Furk’Art ephemera 1984 – 1996, édité par Captures Éditions en 2019 et la conception d’une exposition.
Depuis 2019, l’exposition Furk’Art ephemera a été accueillie dans différents lieux d’art en Europe : Art Brussels, Bruxelles ; le Muhka à Anvers ; le château de Oiron en France ; Greylight Projects, Heerlen, Pays-Bas ; SIS123, La Chaux-de-Fonds, Suisse ; Radicale 1924, Saint-Cirq-Lapopie, France.
Ulay & Marina Abramović, Furkart, septembre 1984
Thomas Rodriguez
•
Plus d’infos
INSTANT ORCHESTRA + SABAR
Grand Ensemble du département jazz du conservatoire de Montreuil dirigé par le saxophoniste Maciek Lasserre, consacré à la pratique collective de la composition, de l’improvisation et à l’exploration du territoire fin situé entre oralité et écriture.
Pour cette occasion ils inviteront la classe de sabar du conservatoire du 7ème arr de Paris dirigée par le percussionniste Ivan Ormond et Mor Junior Ndiaye Rose percussionniste, griot et petit fils de l’illustre Doudou Ndiaye Rose.
Instant Orchestra + Sabar est soutenu par le Conservatoire de Montreuil & Est ensemble
Maciek LASSERRE
Musicien à la créativité singulière, il évolue sur la scène parisienne et internationale avec des projets de jazz contemporain et de rap expérimental.
De 2001 à 2010, il participe à une série de tournées notamment en Afrique (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Maroc, Tunisie) et en Europe.
En 2006, il part étudier la musique de Steve Coleman à New-York. Il y découvre la scène avant-gardiste new-yorkaise avec Steve Lehman, Vijay Iyer et Tyshawn Sorey.
De retour en Europe, il intensifie son travail d’écriture et développe le MCK Projekt à travers lequel il formalise les concepts clés de sa vision musicale, esthétique et philosophique.
En 2015, il co-fonde le groupe Sélébéyone (Pi Recording) avec le saxophoniste et compositeur Steve Lehman, le lyriciste américain HPrizm (Antipop Consortium) et le rappeur sénégalais Gaston aka Bandimic.
En 2020, il est à l’initiative des A.M.E (Atelier de Musiques Exploratives) en collaboration avec le musicien, activiste et philosophe brésilien Fred Lyra .
Son parcours l’a amené à collaborer avec des artistes tels que : Magic Malik, Steve Lehman, Olivier Sens, Jozef Dumoulin, Karim Ziad, Brice Wassy, Doudou Ndiaye Rose, Ablaye Mbaye, Thionne Seck, Hamid Bouchnak, DaBrains, Gaston Bandimic, HPrizm (Antipop Consortium), Mike Ladd, Disiz La Peste, Souffrance, Oxmo Puccino.
Il s’est produit dans des clubs à Paris, New York, Varsovie, Dakar, ainsi que dans de grands festivals internationaux : Berlin Jazz festival, North Sea Jazz Festival, Ecstatic Music Festival New York, Paris Jazz Festival, Festival Gnawa d’Essaouira, Frankfurt Jazz Festival, Francofolies de la Rochelle, Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde…
Maciek Lasserre est aujourd’hui très actif sur le plan pédagogique (CRD Montreuil) et dans le développement du MCK Projekt et de ses ramifications : MCK [S] et A .M.E Atelier de Musiques Exploratives.
Mor Jr NDIAYE ROSE
Mor Jr NDIAYE ROSE est percussionniste sénégalais, issu des deux plus grandes familles de griots sénégalaises, la famille Rose de par son père et de la famille Faye de par sa mère. Dès son enfance il pratique les percussions et apprend les répertoires caractéristiques de ses deux familles mais plus largement de la culture traditionnelle et moderne wolof.
De 1992 à 1997, il accompagne son grand père, l’illustre Doudou Ndiaye Rose, classé par l’Unesco « trésor humain vivant » en 2006, il voyage et participe à de nombreux festivals internationaux.
En 1997, il s’installe en Europe pour poursuivre sa carrière d’accompagnateur. Il jouera aux cotés de figures emblématiques de la musique africaine tels que : Youssou Ndour, Waly seck, Fally Ipupa, Dadju, Hervé Samb.
Il crée en 2018, le groupe Soralé avec cinq membres de la famille Rose. A travers ce projet, il participe à l’hybridation du sabar avec les musiques électroniques.
Il est parallèlement pédagogue reconnu et sollicité pour sa connaissance profonde du répertoire traditionnel et il est un griot très actif et maître de cérémonie dans de nombreux rituels de la communauté sénégalaise.
Ivan ORMOND
Musicien percussionniste, il explore depuis 30 ans les traditions africaines et afro-cubaines et s’est spécialisé dans les musiques mandingues et du Sénégal. Il monte notamment des spectacles et projets autour des percussions sabar du Sénégal et leur langage dans leur dialogue contemporain : « Sabar ring » (création jazz et sabar avec Stéphane Payen), « Paroles de Sabar » (pédagogique), « Aux rythmes d’un fleuve » (Chant et percussions tama avec Demba Ndiaye Ndilaan et les frères Thiam) ou « Cossane » (percussions de St Louis). Il se produit également dans de nombreuses formations de percussions, de jazz (Bertrand Renaudin, Antoine Hervé), et spectacles musicaux (Crescendo, le Roi Lion…), ou avec la danse (Irène Tassenbedo) et le théâtre principalement à Paris et à Londres, mais c’est avant tout un artiste pluridisciplinaire. En parallèle de la musique, il débute sa carrière comme mime et comédien et restera très lié à l’expression corporelle, privilégiant le travail musical en lien avec le chant et la danse. Dans cette démarche, également enrichie d’une longue expérience d’accompagnement de la danse, il développe une pédagogie spécifique à la formation musicale et rythmique des danseurs et des comédiens. Passionné par la transmission des musiques et danses traditionnelles et titulaire du C.A, il enseigne en conservatoire où il valorise la pluridisciplinarité et l’expression collective, piliers de ces cultures.
Concert
Ensemble de SABAR + Instant Orchestra
•
Plus d’infos
Bleached September met en scène des corps comme des surfaces de projection, dans des décors artificiels presque trop irréels.
La série propose une vision fragmentée d’un temps flou, où tout semble délavé, synthétique, mais chargé d’une tension latente.
Crédits : Éditorial TEMPLE magazine @temple.magazine
Stylisme : Koffi Wandji @koffi.w
Mannequins : Iris @erapolis, Apolline Destom @apollune
Roxane Sauvage est une photographe basée à Paris. Formée à l’École Duperré et à la Haute école des arts du Rhin, elle développe une pratique hybride où la photographie numérique dialogue avec des altérations manuelles, le costume et le set design.
Son travail explore la tension entre le naturel et l’artificiel à travers des figures hybrides, à la frontière de l’humain et de l’animal, du familier et de l’étrange. À travers des expérimentations plastiques et numériques, elle interroge la transformation des corps et des couleurs comme processus créatif central. Textiles, matières, objets détournés et structures modulaires deviennent les outils d’une narration visuelle immersive.
La retouche d’image, qu’elle soit artisanale ou digitale constitue un terrain d’exploration privilégié. Chaque projet devient un laboratoire sensible où espace, geste et image interagissent pour redéfinir le corps comme un élément en constante mutation, capable de s’adapter, de résister ou de fusionner avec son environnement.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Bleached September
Roxane Sauvage
•
Plus d’infos
La Machine à mues est un dispositif poétique et spéculatif destiné à fabriquer, archiver et réinventer les mues, ces peaux métaphoriques qui marquent les passages, les transformations, les possibles bifurcations de l’être. À la fois outil de mémoire et générateur de futurs imaginaires, cette mécanique permet de conserver ce qui a été, d’esquisser ce qui aurait pu advenir et de modeler de nouvelles évolutions. Elle interroge notre capacité à changer de peau, à muer, au sens propre comme au figuré, face à un monde en perpétuelle mutation.
Née à Paris en 2001, Céleste Schwartz vit et travaille à Bruxelles, où elle poursuit un master à l’Académie royale des beaux-arts. Son travail, à la croisée de la recherche et du récit, explore la fiction comme outil d’observation et d’anticipation. Elle élabore des fragments de mondes où passé lointain et futur hypothétique se confondent, mêlant archéologie du futur, anthropologie spéculative et récits d’anticipation.
Ses œuvres, qui prennent forme à travers la sculpture, l’installation et la vidéo, sont autant de refuges possibles : espaces imaginaires où l’on peut se retirer, repenser et, peut-être, survivre. Puisant dans la science-fiction, les récits spéculatifs et une attention constante au vivant, elle développe une esthétique singulière qui invite à réévaluer notre rapport au monde et à envisager d’autres manières d’y habiter.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Machine à mues
Céleste Schwartz
•
Plus d’infos
Cette installation réunit 84 diapositives, chacune reliée par un fil rouge à un objet trouvé – fragments de murs, jouets, pièces métalliques, chaussures, vestiges du quotidien. Ces binômes forment une constellation disposée autour d’un autel recouvert de tissu noir, abritant un livre de 16 pages, enchaîné pour n’être consulté que sur place. Le livre compile articles de presse et textes retraçant une certaine vision de l’histoire de la cité de la Renardière à Noisy-le-Sec, où l’artiste a grandi. L’œuvre articule mémoire intime et mémoire collective, faisant dialoguer images, traces matérielles et récits oubliés, dans une réflexion sur la persistance des lieux et des fantômes qui les habitent.
Samy Souiou vit et travaille à Montreuil, où se trouve son atelier. Originaire du quartier de la Boissière, son parcours s’est construit en marge, à travers le graffiti, le dessin et la photographie, comme autant de manières d’habiter et de questionner le territoire. Son approche s’enracine dans la déambulation, la recherche de lieux oubliés, de dents creuses et de passages secrets : autant d’espaces où se déposent des mémoires invisibles qu’il cherche à collecter ou à évoquer.
Autodidacte, également actif comme assistant auprès d’artistes muralistes, il explore aujourd’hui un champ plus élargi d’expérimentations : installations immersives, modélisations 3D, vidéos et archives collectées. Son travail s’attache à relier fragments intimes et récits collectifs, en interrogeant les métamorphoses de l’espace urbain, la disparition des traces populaires et la persistance des fantômes qui habitent les franges du territoire.
Renardière
Samy Soumiou
•
Plus d’infos
Je les ai parcourus, certains de ces chemins qui mènent aux racines d’un secret intime. Je me suis penché pour la ramasser, cette miette, ce fruit authentique tombé de l’arbre. Je l’ai savouré avec les yeux et la bouche, ce visage pâle qui appréciait un peu d’ombre.
On m’avait dit de dompter des chiens déchaînés, des animaux libres enveloppés d’un voile symbolique. Il faut alors se pencher, pour mieux comprendre les ressentiments et les détails des grimaces de la bouche, des yeux ou des plis des joues qui fournissent des preuves utiles pour mieux comprendre les couleurs ma maison.
Sans titre
Filippo Stravato
•
Plus d’infos
Compositrice, chanteuse, pianiste, performeuse, autrice.
Née à Marseille le 24/02/1991.
Diplômée des conservatoires : DEM piano avec Florestan Boutin, DEM écriture avec Isabelle d’Ha, DEM improvisation avec Philippe Pannier, DEM composition avec Martin Matalon, DEM orchestration avec Guillaume Connaisson.
Depuis 2012, elle développe une pratique musicale transversale et se produit sur la scène européenne en tant que chanteuse à texte et musicienne électronique. Elle a composé et mise en scène notamment l’opéra électronique Chute Libre interprété par Oleg Ossina, Étienne Barboux et elle-même (projet produit par la DRAC, Banlieues Bleues, la Région, le Pavillon de Romainville et Les Détours de Babel).
Cet opéra marque la naissance du collectif Love Loin de Dieu avec Oleg Ossina, laboratoire d’œuvres hybrides mêlant musique contemporaine, web-série, spectacles et performances live (La lune pète un câble, Love Loin de Dieu Trio, La Fileuse, Tristesse en plaque, etc.).
Parallèlement, elle a composé pour l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille dirigé par Leo Margue, commande du réalisateur Thomas Ellis pour le film Cargo Kids. Le film reçoit le haut patronage du ministère de l’Éducation et pour la musique le Prix Avant Son du Festival Sœurs Jumelles / Sony Music Publishing. Elle a composé l’œuvre orchestrale Tenetz pour l’Orchestre Philharmonique de Yerevan dirigé par Varan Mardirossian.
Elle fait aussi partie du spectacle pour enfants Chewing Gum Silence mis en scène par Samuel Achache, co-créé avec Antonin Tri Hoang et Thibault Perriard (produit par Banlieues Bleues, la DRAC, la Région, Théâtre de Montreuil, La Sourde, etc.). Ce spectacle qui fit l’ouverture du Festival d’Automne en 2021 et joué entre autre à l’Opéra Bastille, La Philarmonie, etc.)
En 2019, son duo Joe Quartz fait la tournée des grandes salles européennes : Philharmonie de Cologne, Admiralspalast (Berlin), Alte Oper (Francfort), Barbican Center (Londres), Théâtre Carré (Amsterdam), Cirque Royal (Bruxelles), Skandiascenen (Stockholm), Palladium (Varsovie), Sono Centrum (Brno-Žabovřesky), Amager Bio, BETA (Copenhague).
Depuis 15 ans, Jeanne Susin évolue aussi bien au sein des institutions
prestigieuses que dans des lieux marginaux et indépendants. Obsédée par l’explosion des bulles d’univers différents, refusant les étiquettes, elle œuvre pour une poésie musicale de l’étrange qui s’inspire autant de la musique électronique, de la musique acoustique contemporaine, de la noise, des musiques du monde, de la musique classique romantique et avant tout de la chanson.
Elle collabore régulièrement avec différents artistes à l’internationale (Phila Primus, Aya Metwalli, Ornella Noulet, Antonin Tri Hoang, Marguerite Bourgoin, Popline Fichot, Babouillec SP, Christian Boltanski, etc.).
Concert
Jeanne Susin
•
Plus d’infos
Installation-performance de Juli Susin en collaboration avec Hily-Awa Touré (aka HAT).
D’après le livre d’artiste éponyme de 1995, réalisé par Juli Susin, Veronique Bourgoin et Roberto Ohrt, qui met en scène une discussion dans un wagon-restaurant entre un artiste et un historien (Faust et Mefisto) pendant leur voyage entre Berlin et Prague. L’installation est accompagnée de Symphonie n°9 de Dvořák.
Juli Susin vit et travaille à Montreuil et Albisola. Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1991. Sa pratique couvre la photographie, le dessin, la sculpture, le cinema et le livre d’artiste. Dans des années 90, il initie avec l’artiste Véronique Bourgoin plusieurs projets collaboratifs et une école de la photographie expérimentale l’Atelier Reflexe. À partir des années 2000, il établit une plateforme internationale de collaborations autour du livre d’artistes du nom de Silverbridge, aujourd’hui connu sous le nom de Royal Book Lodge et qui a fait l’objet du livre de l’historien de l’art, John C. Welchman publié aux éditions Hatje Cantz, 2023.
Son cycle majeur, Chronos Swimmer, est une recherche au long cours sous forme de fiction autobiographique qui combine l’instalation, film, musique, photographie, céramique, livre d’artiste et les archives. Entre juin et novembre 2023, ce cycle a été présenté au Musée des Abattoirs de Toulouse. La publication du livre Chronos Swimmer par les édition Hatje Cantz est prevu en janvier 2025. Il a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2023.
Le travail de Susin a été exposé dans des institutions telles que : La Chapelle Saint-Augustin, Beaux-Arts de Paris ; Forum Stadt Park Gratz ; Musée d’art contemporain de Mexico ; Musée Oscar Niemeyer, Brésil ; Garage Center, Moscou ; Fotohof, Salzbourg ; Fondation Miglorissi, Asuncion ; Musée des Abattoirs, Toulouse…
Les Fables d’une Étrange Lucarne
Juli Susin
•
Plus d’infos
Cette œuvre explore la manière dont les individus investissent et s’approprient les espaces où ils vivent et travaillent, en ravivant les échanges et les interactions qu’ils abritent. Bancs, fontaines, parcs deviennent ici les matrices de cabanes-refuges anarchiques, proliférant comme des plantes surgissant des fissures d’une usine abandonnée. Ces micro-architectures, à la fois fragiles et résilientes, se veulent des lieux de partage et de création collective, affirmant un intérêt profond pour le travail en commun et la réinvention des usages quotidiens.
La pratique de Ferdinand Thomasson s’ancre dans la création de fictions urbaines : visions inventées et réappropriations sensibles d’espaces publics, destinées à révéler l’invisible et à interroger les usages établis. En détournant des techniques et codes de l’aménagement urbain, il façonne un langage plastique hybride, à la croisée de la sculpture, de l’installation et de la performance. Ses interventions cherchent à « tordre » la réalité, à déjouer les limites imposées par l’urbanisation et à ouvrir des brèches dans le tissu de la ville.
Favorisant les espaces liminaux et non dédiés à l’art, il investit ces interstices pour créer des expériences immersives et inclusives, en dialogue avec toutes les strates qui composent nos environnements urbains. Animé par une vision utopique, il conçoit — souvent au sein du collectif Ygreves — des lieux-refuges propices à la réappropriation de l’imaginaire collectif.
Diplômé des Beaux-Arts d’Annecy (2020), actuellement en master à l’ERG et en formation à la taille de pierre, il poursuit une recherche où la création collective devient acte politique et poétique.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
1 banc – 2 machines à mues
Ferdinand Thomasson
•
Plus d’infos
Artiste éclectique, France a longtemps vécu à Montreuil et vit maintenant au Mexique depuis 2022.
Cet orchestre a été assemblé à Montreuil par l’artiste à partir d’éléments de récupération.
Oubliée pendant de nombreuses années, l’œuvre a été récupérée en 2025 par ENZYME DESIGN dans un chantier naval à St Nazaire.
Elle est présentée aujourd’hui à Mozin’art à l’état statique et sera restaurée prochainement.
L’orchestre de Jazz
France Thiroloix
•
Plus d’infos
Que ce soit au sein de Bada-Bada, le trio instrumental qu’il a cofondé et dont le premier album a été porté aux nues, sur scène aux côtés de Bonnie Banane, ou avec NSDOS pour le projet Poorboys, le batteur et producteur Tiss irradie de sa présence et propulse sa puissance de feu sur de plus en plus de scènes – de Paris à Londres, en passant par La Nouvelle-Orleans.
Chaque apparition de son projet TISS+ se traduit par une expérience à géométrie variable où l’improvisation et le groove seront les seuls maîtres à bord. Dance Jazz Music
Avec :
Tiss Rodriguez batterie/chant
Galawesh Chant
DanDanDan synths
Adrian Edeline Guitare
Concert
TISS+
•
Plus d’infos
Grandir dans une forêt condamnée, apprendre à s’enraciner dans l’éphémère. Les souvenirs d’enfance d’Elia Valet s’effacent avec les arbres, arrachés un à un, livrés aux machines qui les transforment en matériaux muets.
Little people, ou les Treebis, naissent d’un rêve, incarnations anthropomorphes des arbres eux-mêmes, ils viennent câliner leurs dépouilles meurtries en souriant, résilients. Ou, qui sait, peut-être sont-ils des gardiens silencieux, simplement là pour effrayer, hanter les déforesteurs ?
Elia Valet est une plasticienne et artiste pluridisciplinaire de 25 ans, exerçant entre Paris et la Montagne Noire d’où elle vient.
Diplômée en juin 2023 d’un DSAA à l’école Duperré (Paris), elle se professionnalise dans le set design en parallèle de ses recherches et de sa pratique artistique.
Elle fait de la maison de son enfance le cœur de sa pratique, un terrain d’expérimentation du geste ruiniste, comme méthode de production et source de matériaux. Ses travaux témoignent d’une recherche plastique à la croisée de la sculpture et de la performance, de la photographie et de la vidéo, pour habiter l’espace et nous inviter à se promener dans les ruines de sa main.
Créatrice de ses propres mythes, les matières se délitent où les souvenirs s’accumulent.
Chaque activation est l’occasion de créer de nouveaux rituels qui invitent les corps et les
espaces à faire monde. Entre le passé et le présent, on cherche presque à entrevoir le mouvement immobile du temps. Sa prise sur les matières, sur l’imagination. Entre chaos initial et disparition, c’est le processus qui fait sens, l’archive témoigne du cycle. Un glissement de terrain en puissance, la fragilité de ses productions questionne leur propre pérennité.
Une carte blanche par Popline Fichot — Le Jardin d’incidence
« Si les histoires sont les seuls bateaux qui nous permettent de naviguer sur le fleuve du temps, aucune embarcation n’est entièrement sûre dans les grands rapides et les hauts-fonds.”
Ursula K. Le Guin extraite de A Fisherman of the Inland Sea
L’exposition Le jardin d’incidence a été conçue pour Mozinor, une cité industrielle, témoin d’une utopie architecturale des années 1970 : à la fois archive d’un passé productif et laboratoire d’usages contemporains. Ce lieu est un organisme vivant qu’il faut prendre le temps d’apprivoiser : déambuler dans ses sillons, sentir le vent circuler dans ses gorges, laisser sa lumière rougeoyer.
Une salle m’a immédiatement intriguée : celle nichée au sommet de l’édifice. Protégée par des barreaux rougeoyants, on y accède par le seul escalier à sens unique. Une fois à l’intérieur, les lignes convergent, les pans s’inclinent : la salle dévoile un plafond de verre, une voûte prismatique.
Chaque objet déposé dans cette salle est dévié et fragmenté par la lumière solaire, selon le phénomène de réfraction. Les faisceaux lumineux transportent ces fragments vers un autre lieu : objets, reliques, lambeaux et éclats sont projetés sur le sol du jardin, éparpillés autour d’une fontaine octogonale. L’usage et l’histoire de cette fontaine se sont perdus, disséminés parmi les ouvriers qui y travaillent ou y ont travaillé. Pourtant, c’est là que ressurgissent les indices : les traces déposées au sein du prisme. Entre le visible et l’invisible demeurent des fragments que seule la lumière peut saisir. La lumière est à la fois vecteur physique et métaphore : elle sélectionne, amplifie et transforme la perception.
J’ai invité treize artistes de ma génération à s’initier à ce phénomène, chacun·e à travers son propre prisme. Iels sont sculpteur·euses, photographes, peintres, performeur·euses, modeleur·euses d’un monde à la fois captif et captivant.
Une constellation d’artistes qui préfère évoluer dans les rebords accidentés plutôt que sous la lumière froide d’une salle blanche. Une envie de créer collectivement des failles éthérées. Car c’est dans ces interstices, dans ces lieux qui ne sont pas vraiment destinés à… que l’écaille tombée peut conter l’animal entier.
Popline Fichot
Little People, treebi numéro 1, 2 et 3
Elia Valet
•
Plus d’infos
Sur les balustrades de Mozinor, des mains brandissent des pierres : geste archaïque et universel, à la fois outil, arme et fragment de mémoire. En dialogue avec l’architecture brutaliste du site, ces images deviennent des bannières de protestation, inscrivant le soulèvement dans l’espace même du béton.
En écho, des photographies d’explosions, de violences policières et de soulèvements contemporains – fixées sur la céramique, matériau archéologique et pérenne – transforment l’actualité en mémoire durable. Entre fragilité du papier et dureté de la pierre, l’installation met en tension la continuité des luttes et la persistance de la violence.
Les images de Dune Varela ont été imprimées par Prestimage.
Dune Varela (née en 1976 à Paris) vit à Montreuil et travaille à Poush, à Aubervilliers. Après des études de droit à Paris, elle se forme au cinéma au département Film Studies de l’université de New York. Lauréate de la Résidence BMW en 2016, elle a exposé en France et à l’étranger, notamment aux Rencontres photographiques d’Arles, au Musée Nicéphore Niépce, au Musée des Beaux-Arts de Liège, à la Collection Lambert en Avignon, à la Citadelle d’Ajaccio, ainsi qu’à Paris, Bruxelles, Bologne, Milan, Turin, Carrare et Istanbul.
Son travail interroge les frontières de la photographie, en explorant à la fois son héritage et sa fragilité. Elle traite l’image comme une ruine, entremêlant époques et temporalités pour esquisser une archéologie du futur. Dépassant l’impression traditionnelle sur surface plane, elle lui donne une dimension sculpturale en utilisant des matériaux tels que la céramique, le marbre ou le béton. Fragmentées ou brisées, ses œuvres évoquent des ruines contemporaines et ouvrent de nouvelles perspectives, entre discontinuité, absence et recomposition. Cette réflexion visuelle s’étend également à la vidéo et au cinéma, prolongeant son exploration de la mémoire, du temps et des images dans d’autres espaces narratifs.
As life goes on
Dune Varela
•
Plus d’infos
D’après Wikipédia « les Caprimugidae, ou Caprimulgidés en français sont une famille d’oiseaux constituée d’environ 95 espèces existantes d’engoulevents ». On fouille un peu et on apprend dans le journal Libération que « le mot caprimulgidé vient du latin caprimulgus, littéralement « suceur de chèvre ». Dans sa fameuse Histoire Naturelle, Buffon nous informe que « jadis les paysans croyaient que l’engoulevent, oiseau du crépuscule, pénétrait dans les étables à la nuit tombée pour sucer le pis des bêtes ».
L’engoulevent, primitivement, est un donc un oiseau, transformé par la croyance populaire en suceur de chèvres.
Clément Vercelletto, c’est dans Kaumwald que nous l’avons découvert, poussant avec Ernest Bergez musique de club, avant-garde et rumeurs folk imaginaires comme autant de grands cerceaux d’enfants gondolés ou bien servant d’accélérateur de particules aux chansons vernaculaires d’Estrémadure collectées par Marion Cousin. Depuis quelque temps on le reconnaît, entre autres, sous le nom de Sarah Terral en prise sauvage avec les synthés modulaires parmi les plus abrasifs, poétiques, lunatiques qu’on ait entendus depuis lurette. Depuis peu, il joue de la cornemuse (il ressemble à quelque chose comme un oiseau ténébreux soufflant dans une chèvre, si ça vous rappelle quelque chose).
L’Engoulevent est le premier disque à paraître sous son nom civil.
Entièrement composé sur un petit orgue électronique, à la fois pas mal brut, relativement complexe et dont les tuyaux ont été remplacés par des appeaux contrôlés via une interface MIDI (imaginé par le musicien puis fabriqué, réalisé par le luthier Léo Maurel), il a été enregistré dans trois lieux différents aux acoustiques contraires (d’un studio ultra-mat à « d’anciens silos à vin avec vingt secondes de résonance ».
De tout ce disparate naît pourtant une œuvre parfaitement cohérente, qu’on pourrait dire de musique contemporaine, mais que son auteur, plus géographe qu’historien, appelle « paysagère », serpentant agilement d’une composition à l’autre (six en tout) évoquant tout ensemble techno naine à bas pouls, musique trad des confins écoutée la tête sous l’eau, field-recording d’un territoire pour moitié inventé, théâtre pour l’oreille.
Vercelletto convoque ensemble, par la grâce des titres et des matières, parades animales (cui-cui) et propriétés minérales (La tourmaline), délinquance végétale (Le cœur pourri du taro, La grande berce), criques sableuses, pointes rocheuses et marais modestes (Hoëdic long). Tout en cliquetis, bruits de touches et pépiements de valves, polyrythmies sourdes, soupirs électroniques et haleines fantômes, L’Engoulevent donne à entendre la musique forcément inquiète, forcément féérique, de tout un tissu vivant et hypersensible : le nôtre.
Florian Caschera
Clément Vercelletto est co-programmé par les Instants Chavirés.
Clément Vercelletto est musicien et metteur en scène, sa démarche artistique tend à trouver les points de friction et de clarté entre ces deux pratiques ; ou comment le sonore devient un postulat, pour activer le corps et la voix des interprètes sur scène.
Le sonore, la musique comme un moyen, un vecteur pour improviser, écrire sur le plateau, mettre en scène. La musique, il l’envisage avant tout comme une matière (au sens énergétique et organique du terme), une matière à pétrir avec les mains, avec le corps.
Sa démarche consiste à proposer aux interprètes des procédés sonores dont ils s’emparent tels des cadres formels, des postulats, des matières premières permettant d’engager le corps et/ou la voix. Les matériaux ainsi collectés deviennent petit à petit le socle de l’écriture en constant aller-retour avec le plateau.
Il y a aussi l’idée de révéler (au sens photographique du terme) les fictions qui se trouvent en potentiel sous nos yeux/oreilles.
Une autre manière de le formuler serait de dire que le théâtre, la fable est là partout, tout le temps, et qu’il ne demande qu’à être activé. Il y aurait donc – en substance, dans la moelle épinière de chacune de ces tentatives à produire du son – du théâtre, de la danse, de la fiction à faire jaillir.
Dans ce sens, il travaille avec la réalité, sur ce qui est déjà là, sur la perception, sur le visible et l’invisible, sur l’infra-ordinaire, sur ce qui fait événement.
Son travail est montré dans des lieux/contextes tels que : Pompidou Kanal Bruxelles, Le Palais de Tokyo Paris, Café OTO Londres, Festival MUSICA Strasbourg, La Gaité Lyrique Paris, Musicas Hibridas Bogota, Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, Impulse Tanz Vienne, Théâtre de la Bastille Paris, USINE C Montréal, Biennale du GRAME Lyon, Festival Actoral Marseille, Grrrnd Zero Lyon, FRAC des Pays de la Loire, Le Bal Paris, Festival Sonic Protest Paris, Les SUBS Lyon, Festival de la Citée Lausanne …
Sa musique paraît sur des labels tels que : Opal Tapes, In Paradisum, Standard Infi, Three Four Records, Un Je Ne Sais Quoi, Les Disques du Festival Permanent, Tomaturj, A100P, La République des Granges …
Ses projets sont notamment soutenus en co-production par : La Scène Nationale d’Orléans, CCN de Caen, La Soufflerie Rezé, La Muse en circuit CNCM, Les SUBS Lyon, Musica Festival Strasbourg, GRAME CNCM Lyon, Le GMEA CNCM Albi, ainsi que la Drac ARA et la ville de Lyon.Entre 2021 et 2023 il est artiste associé à La Soufflerie à Rezé (direction Cyril Jollard).
Concert : L’Engoulevent
Clément Vercelletto
•
Plus d’infos
Caco est le demi-dieu grec cité par Virgile dans l’Énéide, mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans une caverne avec ses cacarecos et qui, la nuit, volait, jusqu’à être tué par Hercule.
De Caco viennent les céramiques, les marmites, le feu, l’assombrissement, l’erreur.
Caco est le milieu du chemin entre dieux et humains, humains et animaux, l’entier et le fragmenté. Il est fils d’un dieu boiteux, de l’incomplétude et de l’anéantissement. Il nous salue par l’illégalité et le mépris de la propriété.Il crée de fausses pistes comme celles des traces des sabots des vaches sur le sol en les tirant par la queue pour qu’elles marchent à reculons.
Leurres, failles de l’archéologie, discontinuités géologiques, anomalies stratigraphiques, pointant dans la direction opposée à sa fin, la caverne.
Avec le temps, les tessons s’amoncellent, les classes se mélangent, les continents deviennent trop étroits : il faut plus d’espace, et qu’il soit plat
S’il n’y avait pas les héros, nous serions à l’abri des certitudes.
« monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. » (Virgile, Énéide, liv. III, v. 658)
Petit glossaire :
Caco / Cacus : fils de Vulcain (Dieu des forges et des volcans). Dans les langues romanes (portugais et espagnol), son nom devient « caco », fragment, tesson, reste. Entre entier et brisé.
Cacarecos / Caccabu : Du latin vulgaire caccabus : quelque chose de peu de valeur, diachronique, obsolète, usé, ou bien ce qui sert à donner de la consistance au mortier.
L’œuvre de Claudia Washington a été réalisée en collaboration avec Prestimage.
Claudia Washington est une artiste et chercheure en art contemporain, d’origine brésilienne, installée en France depuis 2019. Elle explore les espaces comme champs de tensions et de flux matériels, sociaux et géologiques. Son travail comprend des installations dans l’espace public, des performances, des œuvres collectives et des expositions muséales, intégrant photographie, dessin, sculpture, céramique, textes et vidéo. Le caractère participatif de son art s’inscrit dans la lignée des collectifs d’artistes brésiliens et des politiques culturelles des années 2000 axées sur la participation populaire, auxquelles elle a pris part activement. Ses œuvres ont été présentées au Festival Mozin’Arts (Montreuil), à la Bienal Internacional de Curitiba (Brésil), au Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), ainsi que dans d’autres expositions internationales.
Pari avec Caco
Claudia Washington
•
Plus d’infos
L’artiste multidisciplinaire parisienne Violeta West imagine des paysages surréalistes et colorés, des formes et des corps asymétriques. Cette vision se reflète dans ses œuvres d’art et ses productions musicales. Parmi ses productions originales, on trouve « Tourne-Tête », un morceau club aux percussions puissantes destiné à enflammer les foules. Ses sets de DJ puisent dans un océan de catalogues prêts à enflammer les dancefloors, allant du bmore au rap, en passant par la techno, le dub, le grime, le breakbeat, la jungle et bien d’autres styles, comme vous pouvez le découvrir dans ses différentes émissions sur Rinse France.
DJ set
Violeta West
•
Plus d’infos
Artistes exposant·es :
Fabienne Francfort
Catherine Minot
Romuald Cardon
Benoit Graisset-Recco
Le groupe Les yeux dans le dos est né de la rencontre de six photographes amateur·ices passionné·es au sein d’un atelier de la Maison Populaire. Six Montreuillois·es, et autant de regards sur le monde, mais une même envie de partage d’expériences et d’émotions, de connaissances et de prises de recul sur leurs productions.
Les membres du collectif ont décidé ensemble de se rendre visibles.
Mozin’Arts est pour eux l’occasion de présenter leurs photos dans un site architectural remarquable, en bénéficiant du savoir-faire de Prestimage, imprimeur numérique installé à Mozinor depuis 2008.
Installation collective de photographies
Les yeux dans le dos
•
Plus d’infos
Josef Zekoff est un peintre, dessinateur et éditeur autrichien qui vit et travaille à Vienne. Il est cofondateur de la célèbre maison d’édition Harpune Verlag, créée à Vienne en 2010 et spécialisée dans les livres d’artistes en édition limitée, qui publie notamment la série Moby Dick Filet. Les peintures de Zekoff s’intéressent profondément à la place de l’être humain, représenté sous la forme de figures nues et vulnérables, de labyrinthes architecturaux ou d’objets quotidiens qui apparaissent comme des reliques archaïques, transportant leur présence mythifiée dans le présent. Ses images se lisent comme des symboles de la mémoire et de l’incertitude de notre position dans le monde. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions individuelles et collectives à l’échelle internationale, notamment à Hambourg, New York, Vienne, Los Angeles, Munich, Copenhague et Berlin.
Josef Zekoff
•
Plus d’infos
Sous l’ombre est une passerelle photographique entre des bâtiments emblématiques : les édifices de la Cité Universitaire, et la Zone Industrielle de Mozinor.
Le travail d’archive et de témoignage est avant tout un prétexte pour faire de belles photos car parfois nul besoin de théoriser la terre entière.
Cette série a été réalisée dans le cadre de l’Atelier de Photographie Argentique mené par Yanis Houssen, dans le laboratoire de la Fabrique des Illusions, à Mozinor, où les auteur.es ont découverts les procédes de la photographie argentique. Les tirages des images ont été réalisés sur les papiers photos de Véronique Bourgoin.
Synthèse est une composition de toiles réinvesties par des aplats de teintes de Mozinor. À travers cette palette l’objectif est de synthétiser l’imbrication des couleurs dans cette architecture.
Accompagné d’une édition, nous mettons en avant les éléments clé du bâtiment, représentés proportionnellement. La réutilisation de toiles anonymes et la transparence est une illustration des multiples vies de Mozinor des années 70 à son allure actuelle.
Zig et Zig est un duo composé de Marius Chudeau et Chloé Duffaud, étudiants en graphisme à l’Ensaama – Olivier de Serres. Leur pratique est tournée autour de la photographie argentique, de l’analyse de l’espace et du corps.
Sous l’ombre ; Synthèse
Zig & Zig :
Marius Chudeau
& Chloé Duffaud
•